Les QCM interactifs sont accessibles � partir de la page d�accueil
du coaching virtuel � acc�s gratuit dilingco.com
Page 1.
Fonctions sanguines
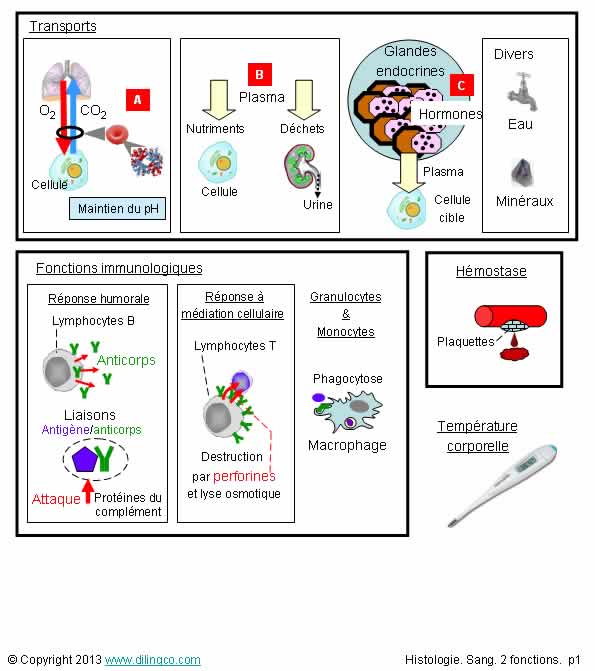
S�lectionnez
les deux affirmations exactes :
1-
[A] : les mol�cules d�h�moglobines des h�maties transportent de l�oxyg�ne
et du gaz carbonique
2-
[B] : les plaquettes transportent des nutriments ou des d�chets
3-
[C] : les glandes endocrines s�cr�tent des vitamines � destination de
cellules cibles ; les leucocytes transportent ces vitamines
4- Les
lymphocytes sont, des 5 types de leucocytes, les seuls � avoir des fonctions
immunitaires
5-
H�molyse : les plaquettes bouchent les blessures et �vitent la d�perdition
de sang
6- Une
baisse des GR peut traduire une an�mie; Une augmentation des PNN une infection
bact�rienne
Les affirmations
1 et 6 sont exactes.
Affirmation
2
Non.
[B] :
le plasma assure le transport de certains nutriments et de certains d�chets.
Exemples :
- L�ur�e
est un d�chet azot� de d�gradation des prot�ines par le foie.
Le taux d�ur�e
dans l�urine compar� � l�ur�mie (taux d�ur�e dans
le sang) permet de diagnostiquer des insuffisances r�nales.
-
mol�cule de Cholest�rol
Affirmation
3
Non.
[C] :
les glandes endocrines s�cr�tent des hormones � destination de cellules cibles.
Voir aussi :
Communications
cellulaires
Vitamine
Affirmation
4
Non.
Les 5 types de cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me
immunitaire : Granulocytes (neutrophiles, �osinophiles, basophiles),
monocytes, lymphocytes.
Neutrophiles : cellules amibo�des phagocytaires des
bact�ries et autres substances �trang�res.
�osinophiles : possibilit�s phagocytaires inf�rieures �
celles des neutrophiles. Phagocytose des complexes antig�nes-anticorps.
(Voir pages ci-apr�s)
Basophiles : S�cr�tent de l�histamine et de l�h�parine pour les r�actions allergiques et
inflammatoires.
Pr�curseurs des mastocytes des tissus conjonctifs.
Mastocytes :
- longue dur�e de vie et possibilit� de prolif�ration,
- r�le dans les allergies (r�actions inappropri�es).
Monocytes : pr�curseurs des macrophages.
Lymphocytes : 3
familles : lymphocytes T, lymphocytes B, lymphocytes NK. (Voir pages ci-apr�s)
Affirmation
5
Non.
H�mostase : m�canisme d�arr�t du saignement.
H�molyse : Destruction des globules rouges par la rate, le foie, la moelle.
H�matocrite : pourcentage de globules rouges par rapport au volume sanguin
H�matome : amas interne de sang par h�morragie suite � un choc,
une prise de sang, etc.
�
Affirmation
6
Oui.
- Baisse des GR : an�mie ?
- Augmentation des PNN : infection bact�rienne ?
(PNN :
polynucl�aires/granulocytes neutrophiles)
- Augmentation des PNEo : allergie ? Infection parasitaire ?
Exemples
d�allergies : rhume des foins, asthme
(PNEo :
polynucl�aires/granulocytes �osinophiles)
Augmentation des lymphocytes : infection virale ?
L�an�mie :
- se
d�finit par un taux d�h�moglobine insuffisant,
- des
sympt�mes tels que asth�nie (fatigue), tachycardie, p�leur, c�phal�e, vertige,
etc.
An�mie
Rappels :
R�le du syst�me immunitaire
Le syst�me immunitaire est charg� de la d�fense de l�organisme contre tout �l�ment
�tranger ou anormal, tels que bact�ries, virus, cellules canc�reuses, etc.
Composition
Le syst�me immunitaire est constitu� d�un
ensemble complexe de mol�cules, de cellules (exemple : les leucocytes), de tissus et
d�organes (rate, thymus).
Les composants du syst�me immunitaires sont reli�s entre eux par
la circulation
sanguine et la circulation lymphatique.
Page 2
Prot�ines & transport
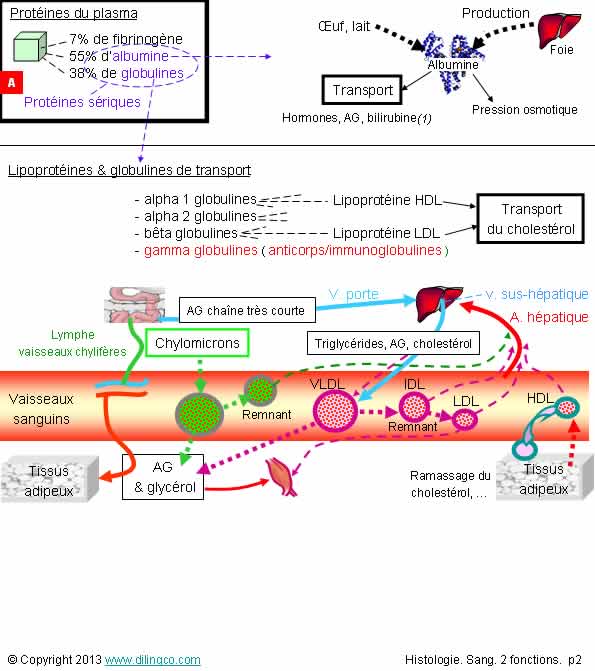
S�lectionnez
l�affirmation exacte :
1- Le
plasma ne transporte que des cellules
2-
L�albumine est transport�e par les globules rouges
3-
[A] : L�albumine et les globulines sont les deux types de � prot�ines
s�riques �
4-
L�h�moglobine et le cholest�rol sont des prot�ines s�riques
L�affirmation
3 est exacte.
Affirmation
1
Non.
Le sang
transporte des cellules.
Le plasma
transporte le fibrinog�ne et les �l�ments de la substance fondamentale.
Plasma
sanguin : MEC, matrice extracellulaire liquide, du sang.
MEC :
fibrinog�ne + substance fondamentale.
Substance
fondamentale : eau, prot�ines s�riques, autres.
Autres
composantes du plasma :
- Glucose,
- lipides
(triglyc�rides, cholest�rol),
-
substances azot�es non prot�iques (acide amin�s, ur�e et acide urique, cr�atine,
bilirubine, �)
- Hormones,
-
compl�ments plasmiques, cytokines,
- vitamines,
-
ions (Na+, Ca2+ , K+, Cl-, �)
- O2,
CO2, N,
- �
Voir aussi
Composition Lec/Lic
Affirmation
2
Non.
L�albumine est une prot�ine du plasma.
L�albumine
se fixe sur les acides gras, sur la bilirubine, sur certains ions m�talliques
et certains m�dicaments. En s�y fixant, l�albumine
assure des fonctions de transport.
Bilirubine :
pigment jaune produit de d�gradation d�un globule rouge.
Accumulation
anormale : jaunisse (ict�re)
Bilirubine
(Voir
dans ce site la partie cin�tique de l�h�molyse,
destruction, des globules rouges)
Affirmation
3
Oui.
Prot�ines s�riques : prot�ines contenues dans le s�rum.
S�rum : plasma � fibrine
Prot�ines s�riques :
- Albumine : 32 � 50 grammes par litre de s�rum
sanguin,
- Globulines :
���� �-
alpha 1 globuline : 1 � 4 g/l,
����� - alpha 2 globuline : de 5 � 11 g/l,
����� - b�taglobulines : 7 � 13 g/l,
����� - gammaglobulines : 7 � 15 g/l.
Globuline
Affirmation
4
Non.
Le cholest�rol
n�est pas une prot�ine mais un st�rol,
compos� � caract�re lipidique.
L�h�moglobine :
- pas une
prot�ine s�rique (s�rique : prot�ine du s�rum)
- 250
millions environ de mol�cules d�h�moglobine dans
les globules rouges,�
-
prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine �
identiques 2 � 2 (2 h�lices alpha, 141 AA, et 2 h�lices b�ta, 146 AA)
Page 3
H�moglobine
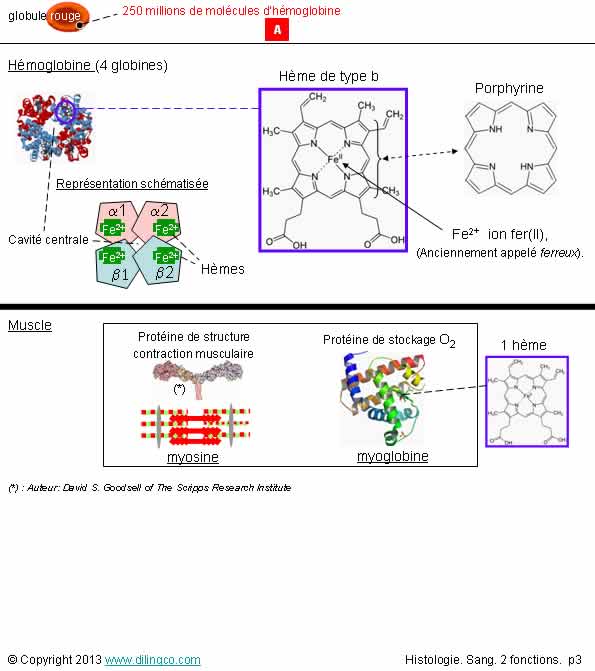
S�lectionnez
les deux affirmations exactes :
1- Le plasma = �l�ments figur�s du sang
2-
[A] : myoglobine
3- H�moglobine :
prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine �
identiques 2 � 2 (2 h�lices alpha, 141 AA, et 2 h�lices b�ta, 146 AA)
4- Chaque
globine contient un h�me. Un ion fe2+ est pr�sent dans chaque h�me
5- Le
globule rouge est un lymphocyte
6- Il n�y
a qu�un type d�h�moglobine humaine
Les
affirmations 3 et 4 sont exactes.
Affirmation
1
Non.
Le plasma est la partie liquide du sang.
Le plasma est principalement compos� d'eau.
On y trouve des substances organiques, des
d�chets, des �l�ments min�raux, des gaz dissous, des prot�ines (albumine,
lipoprot�ines, globulines), etc.
Les �l�ments figur�s du sang
sont :
- les globules rouges ou h�maties ou �rythrocytes,
- les globules blancs ou leucocytes,
- les plaquettes.
Un globule rouge contient environ 250 millions de mol�cules d�h�moglobines.
CCMH : de 32 � 36 g/100 mL.
CCMH :
Concentration corpusculaire moyenne en h�moglobine
Affirmation
2
Non.
H�moglobine.
L�h�moglobine
contient un h�me dans chaque une de ses
quatre cha�nes. C�est un exemple d�h�t�roprot�ine
� structure quaternaire.
La
myoglobine, apparent�e � l�h�moglobine, est un monom�re (form�e d�une seule
sous unit� compos�e de 153 acides amin�s et d�un h�me).
De part
l�affinit� � l�oxyg�ne :
- L�h�moglobine est une prot�ine de transport
(Affinit�
O2 variable en fonction du pH).
- La myoglobine est une prot�ine de stockage.
(Grande
affinit� � l�oxyg�ne).
Affirmation
3
Oui.
L�h�moglobine
est une prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes
� globine � identiques 2 � 2 (2 alpha, 141 AA, et 2 b�ta, 146 AA)
Affirmation
6
Non.
H�moglobine A. alpha2 b�ta2. La plus courante.
H�moglobine A2. alpha2 delta2. Minoritaire.
H�moglobine F. alpha2 gamma2. H�moglobine
f�tale ; meilleure affinit� avec l�oxyg�ne.
Se rappeler :
Les
prot�ines peuvent �tre class�es suivant leurs compositions.
Deux
grands types :
Les
� Holoprot�ines �, les
prot�ines ne contenant que des acides amin�s.
Les � h�t�roprot�ines �, prot�ines avec :
- une partie prot�ine (l�apoprot�ine), et
- une partie non prot�ique (exemple : h�me et ion Fe2+).
Ne pas
confondre :
- La myosine,
Prot�ine de structure, compos�e de deux cha�nes polypeptidiques d�environ 2000
acides amin�s. Par les modifications de sa structure, la myosine est � la base
des m�canismes de contraction musculaire.
- La myoglobine,
Prot�ine globulaire des cellules musculaires, elle est apparent�e �
l�h�moglobine (la myoglobine est un monom�re alors que l�h�moglobine est un
t�tram�re).
La myoglobine est une h�t�roprot�ine contenant un h�me.
A cause
de sa trop grande affinit� � l�oxyg�ne, la myoglobine n�est pas, comme
l�h�moglobine, une mol�cule de transport, mais plut�t une mol�cule de stockage de l�oxyg�ne dans les muscles.
Page 4.
Fonction transport de
l�h�moglobine

S�lectionnez
les deux affirmations exactes :
1- H�moglobine :
une prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine �
identiques 2 � 2 (2 alpha, 141 AA, et 2 b�ta, 146 AA)
2- H�moglobine :
une prot�ine de stockage de l�oxyg�ne (comme la myoglobine)
3- Le pH
ambiant agit sur la configuration spatiale de la mol�cule d�h�moglobine ;
La configuration spatiale modifie l�affinit� � l�oxyg�ne ou au gaz carbonique
4- D�oxyh�moglobine :
mol�cule d�h�moglobine charg�e en oxyg�ne
Les
affirmations 1 et 3 sont exactes.
Affirmation
2
Non.
L�h�moglobine est une prot�ine de transport :
- de l�O2,
ou
- du CO2
& H+
A cause
de sa trop grande affinit� � l�oxyg�ne, la
myoglobine n�est pas, comme l�h�moglobine
(affinit� O2 variable en fonction du pH), une mol�cule de transport.
La myoglobine est une mol�cule de stockage de l�oxyg�ne dans les muscles.
Texte d�explications :
Le r�le
principal de l�h�moglobine est :
- le transport de l�oxyg�ne vers les tissus,
- l��vacuation des ions H+ et du CO2.
En pr�sence d'oxyg�ne, les sels ferreux
(Fe2+) s'oxydent/se r�duisent
rapidement en fonction du pH.
Les sels ferreux servent au transport.
Forme
R, relax�e
Dans
cette forme relax�e :
- La
mol�cule d�h�moglobine n�est pas charg�e,
- La
cavit� centrale est r�duite,
- La
mol�cule d�h�moglobine a une forte affinit� pour O2
(Et
faible pour CO2 et H+).
Chargement
en dioxyg�ne
Figure
(1)
La
capture d�un O2 par une globine augmente l�affinit� des autres
globines pour l�O2 : il y a interaction
coop�rative entre globines et r�action en cascade acc�l�rant la capture des dioxyg�nes.
Passage
de la forme R � la forme T, tendue
Figure
(2)
A
l�approche d�une cellule � pH bas, les h�lices alpha des globines se modifient,
la cavit� centrale s�agrandie, la position spatiale du Fe par rapport au plan
de l�anneau de porphyrine change.
L�affinit� de l�h�moglobine � l�oxyg�ne diminue.
Changement
de chargement
Figure
(3)
L�oxyg�ne est lib�r� et capt� par la cellule qui en a besoin.
Le pH de la cellule r�ceptrice d�oxyg�ne augmente ; l�h�moglobine se charge en CO2 et ions H+
Lib�ration
du CO2
Figure
(4)
Le CO2
de la mol�cule d�h�moglobine, alors appel�e d�oxyh�moglobine, est lib�r� dans
les alv�oles pulmonaires
Voir Syst�me respiratoire.
L�h�moglobine
reprend sa forme relax�e, lui permettant de se recharger en O2.
Notes :
- Le CO2 se connecte aux extr�mit�s N-terminales
des globines et il est facilement lib�rable.
- L�ion H+ se lie � des r�sidus des cha�nes prot�iques.
- En pr�sence de monoxyde de carbone
CO, l�h�moglobine se charge en CO.
Le CO se fixe sur le fer, et, avec une
affinit� beaucoup plus �lev�e que l�O2, est
difficile � d�loger = intoxication.
Page 5.
Antig�ne. Anticorps

S�lectionnez
les deux affirmations exactes :
1- Un
lymphocyte B n�est capable de reconna�tre qu�un seul antig�ne
2- Unicit�
de reconnaissance des lymphocytes : tr�s peut d�agents infectieux peuvent
�tre combattus par le syst�me immunitaire
3- Un
antig�ne a un d�terminant antig�nique (un �pitope). L��pitope d�un agent
infectieux d�clenche g�n�ralement une r�ponse immunitaire
4- Un
anticorps est capable de reconna�tre une multitude d�antig�nes
5- Seuls
les agents infectieux ont des antig�nes
6- Les cellules
avec des HLA non conformes ne sont pas d�truites
Les affirmations
1 et 3 sont exactes.
Affirmation
1
Oui.
Les
lymphocytes sont sp�cialis�es pour d�tecter un d�terminent antig�nique
sp�cifique.
1 lymphocite = 1 r�cepteur = 1 �pitope.
Un �pitope :
-
correspond � la partie de l�agent infectieux reconnue par un r�cepteur et
un anticorps,
- peut
�tre peptidique (jusqu�� une quinzaine
d�AG),
- peut
�tre un polysaccharide (5 � 6 sucres).
Note :
Agent
infectieux, pris ici au sens large : peut �tre une cellule contamin�es,
canc�reuse, une bact�rie, une toxine de bact�rie, un virus, ��
Affirmation
2
Non.
1 lymphocyte
= 1 r�cepteur = 1 �pitope
Oui, mais
le corps produit des centaines de milliers de
types diff�rent de lymphocytes !
(Chacun
sensible � un �pitope particulier)
Affirmation
3
Oui.
Antig�nes
pathog�nes : antig�nes de bact�ries ou de toxines, de virus, de cellules
canc�reuses.
Toxine : mol�cule toxique fabriqu�e par une
bact�rie pathog�ne.
Exemples : toxine botulique, t�tanique, chol�rique, dipht�rique, etc.
Affirmation
4
Non.
1 anticorps reconna�t 1 antig�ne
Affirmation
5
Non.
Antig�nes :
- pr�sents
sur les membranes des cellules de l�organisme et sur les agents infectieux,
- macromol�cules reconnues par le r�cepteur d�une
cellule immunitaire ou par un anticorps,
- sont
des prot�ines, des polysaccharides et les d�riv�s
lipidiques,
- peuvent
�tre pathog�nes, provoquer des r�actions immunitaires et �tre responsables de
maladies.
- 2
classes d�antig�nes.
Antig�nes
classe 1
- antig�nes pr�sents sur les membranes de toutes les cellules de
l�organisme, �
l�exception des cellules germinales.
- antig�nes appel�s HLA, mol�cules du CMH
HLA : Antig�nes des leucocytes humains (HLA),
CMH : Complexe� majeur d�histocompatibilit�.
- Les
globules rouges ont des marqueurs mineurs, les agglutinog�nes.
Antig�nes
classe 2
Antig�nes
suppl�mentaires pr�sents sur les membranes des cellules immunitaires CPA, Cellule pr�sentatrice d�antig�ne
(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)
Note :
Agent
infectieux, pris ici au sens large : peut �tre une cellule contamin�es,
canc�reuse, une bact�rie, une toxine de bact�rie, un virus, ��
Affirmation 6
Si.
Le syst�me immunitaire utilise le
HLA, empreinte unique par individu, appos� sur toutes les cellules
d�un individu, pour distinguer les cellules �trang�res, non conformes, et les
d�truire.
Rappel. Cellules immunitaires
Leucocytes (ou globules blancs)
- Famille de cellules du syst�me immunitaire.
- Produites dans la moelle osseuses.
-
Pr�sents dans le sang, la lymphe, les organes lympho�des, et de nombreux tissus
conjonctifs.
Organes lympho�des : Ganglions, rate, amygdale et v�g�tations, plaques de
Peyer).
Voir : Trajet des leucocytes
Les cellules leucocytes du syst�me immunitaire :
Granulocytes, monocytes, lymphocytes.
Pourcentages :
Granulocytes
��� Neutrophiles, de 50 � 70 %
��� Eosinophiles, de 2 � 4 %
��� Basophiles, de 0,5 � 1 %
Lymphocytes, de 20 � 40 %
Monocytes, de 3 � 8 %
Granulocytes
- Leucocytes, globules blancs � non sp�cifique � (non d�di� � un
antig�ne sp�cifique).
- Tr�s nombreuses granules dans le cytoplasme.
- Granulocytes neutrophiles, basophiles, �osinophiles
(Le nom est li� � leur affinit� � un colorant neutre,
basique, ou �osine)
- Neutrophiles : phagocytes.
- Basophiles : d�versent de l�histamine pour attirer les autres
globules blancs.
- �osinophiles : d�versent des enzymes sur les parasites.
Monocytes
Les monocytes sont des cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me immunitaire.
- Plus grosses cellules qui circulent dans le sang,
- Cellules mobiles,
- Phagocytes : macrophages dans les tissus conjonctifs, microglycocytes
dans le SNC, ost�oclastes dans l�os.
Lymphocytes
Les lymphocytes sont des cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me
immunitaire.
2 lign�es : lymphocytes T et lymphocytes B.
Lymphocytes T :
- Leur d�veloppement s�ach�ve dans le thymus,
- Lymphocytes cytotoxiques (d�truisent les cellules infect�es),
- Lymphocytes auxiliaires,
- Lymphocytes suppresseurs.
�rythrocytes (H�maties, ou globules rouges)
- Cellule d�pourvue de noyau (anucl��),
- cytoplasme riche en h�moglobine,
- assure le transport O2 et CO2
Thrombocytes (Plaquettes)
R�le important pour la coagulation sanguine.
Mastocytes
- Cellules normalement pr�sentes dans les tissus conjonctifs (et
non dans le sang),
- Tr�s nombreuses granules dans le cytoplasme.
- Les granules contiennent des m�diateurs chimiques comme la s�rotonine, l�histamine,
la tryptase ou l�h�parine.
- Les granules sont lib�r�es au contact d�un allerg�ne.
Plasmocytes
- Cellules normalement pr�sentes dans les tissus conjonctifs (et
non dans le sang),
- Globules blancs.
Page 6.
M�canisme de d�fense.
Lymphocytes B

S�lectionnez
les deux affirmations exactes :
1- [A] : Un r�cepteur de lymphocyte B n�est pas sp�cifique �
un d�terminant antig�nique particulier
2- Apr�s
reconnaissance d�un antig�ne, les lymphocytes B se diff�rentient en plasmocytes
et en lymphocytes B � m�moire
3- Lymphocytes B : lib�rent les immunoglobulines solubles
dans l�environnement qui d�truisent directement les agents infectieux
4- Une fois activ�, un lymphocyte B se diff�rentie en lymphocyte T
5- Lymphocytes B : r�ponse immunitaire humorale
(reconnaissance directe du pathog�ne, s�cr�tion d�anticorps, actions
destructives par les anticorps, �
Les affirmations 2 et 5 sont exactes.
Affirmation 1
Si.
[A] : Le r�cepteur LB est sp�cifique � un d�terminant antig�nique
particulier.
1 lymphocyte B = 1 r�cepteur BCR = 1 �pitope = 1 antig�ne.
(Epitope = d�terminant antig�nique)
Affirmation
2
Oui.
Les
lymphocytes � m�moires permettent � l�organisme d�avoir une r�ponse
beaucoup plus rapide et plus durable si l�agent pathog�ne se repr�sente.
Ils ont
une dur�e de vie plus longue que les plasmocytes.
Affirmation 3
Non.
Ce sont les Plasmocytes qui lib�rent les immunoglobulines (les
anticorps).
Plasmocytes : diff�rentiation finale des lymphocytes B.
Ce ne sont pas les immunoglobulines (les anticorps) qui d�truisent
les agents infectieux.
Affirmation 5
Oui.
Lymphocyte B : � r�ponse humorale �. Lib�ration d�anticorps,
ou immunoglobulines, par les plasmocytes.�
Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation cellulaire �.
Page 7.
CMH. CPA
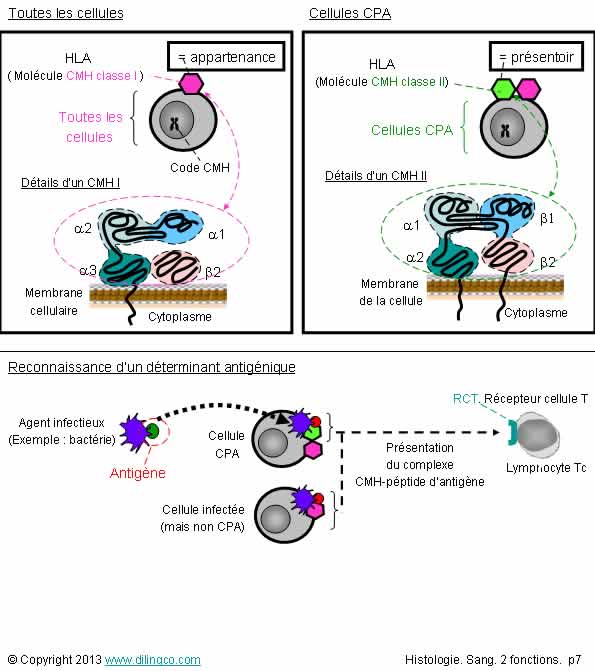
S�lectionnez
l�affirmation exacte :
1- Les
lymphocytes Tc, cytotoxiques, peuvent reconna�tre directement les antig�nes
2- La
mol�cule CMH classe I est une prot�ine compos�e d�une cha�ne alpha et d�une
b�ta 2
3- La
mol�cule CMH classe I, � Complexe majeur
d�histocompatibilit� �, n�est pas impliqu�e dans les
ph�nom�nes de rejets de greffes
4- Seules
les cellules CPA peuvent pr�senter un complexe CMH-peptide d�antig�ne aux
lymphocytes T
L�affirmation
2 est exacte.
Affirmation
1
Non.
Les
antig�nes doivent leur �tre pr�sent�s dans un ensemble CMH-p�ptide d�antig�ne
pour �tre reconnus par les lymphocytes Tc.
Les antig�nes doivent �tre retravaill�s pour donner un peptide
sp�cifique. Ce
peptide s�associe � la prot�ine CMH pour que l�ensemble soit reconnu par une
des millions de lymphocytes T.
Affirmation
4
Non.
A
l�exception des cellules germinales, toutes les cellules ont des mol�cules CMH
sur leur membrane.
Les cellules CPA, cellules
� professionnelles � de la pr�sentation immunitaire, ont en plus des mol�cules CMH classe II.
Les
lymphocytes peuvent d�tecter :
- des
complexes CMH-peptides d�antig�ne anormaux,
- des CMH
I d�t�rior�s ou n�appartenant pas � l�organisme de l�individu
(Exemple :
cellule canc�reuse).
Lymphocyte B : � r�ponse humorale �. Lib�ration d�anticorps ou
immunoglobulines par les plasmocytes.�
Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation cellulaire �.
CPA : Cellule pr�sentatrice d�antig�ne
(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)
CMH : Complexe majeur d�histocompatibilit�
R�gion du g�nome qui code les mol�cules HLA connues.
HLA : Antig�ne des leucocytes humains
(Humain
Leucocyte Ag.)
Les mol�cules
HLA, aussi appel�s � mol�cule du CMH �,�
sont � la surface de toutes les cellules.
(�
l�exception des neurones, de la corn�e, des glandes salivaires, des h�maties,
�).
Les mol�cules HLA sont sur toutes les cellules :
CMH de classe I = marqueurs d�identit� d�un individu.
HLA
suppl�mentaires sur certains leucocytes : CMH
de classe II
Les CMH de type II servent de pr�sentoirs d��l�ments ext�rieurs.
Page 8.
Pr�sentation aux
lymphocytes T
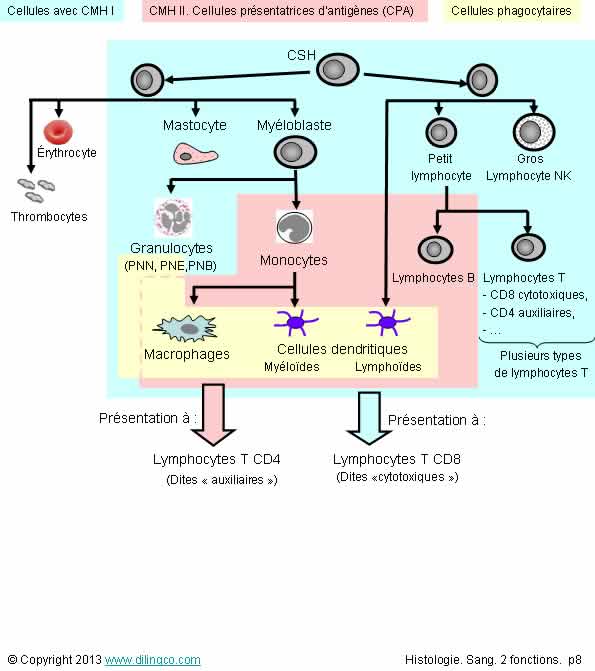
S�lectionnez
les deux affirmations exactes :
1- Les
mol�cules du CMH-I sont pr�sentes sur toutes les membranes des cellules
nucl��es
2- La
membrane d�une cellule nucl��e ne porte qu�une seule mol�cule CMH-I
3- Un macrophage
est une cellule phagocytaire, pr�sentatrice d�antig�ne aux lymphocytes T CD8
4- Un
macrophage n�a pas de mol�cule CMH-I
5- Les lymphocytes B peuvent reconna�tre directement les
pathog�nes et agir en cons�quence. Les lymphocytes B sont aussi des cellules
pr�sentatrices d�antig�nes
Les affirmations 1 et 5 sont exactes.
Affirmation
1
Oui.
Donc les
mol�cules du CMH-I ne sont pas pr�sentes sur les membranes des globules rouges.
Affirmation
2
Non.
6 types
de mol�cules CMH-I (2 mol�cules HLA-A, 2 mol�cules HLA-B et 2 HLA-C).
Pour chaque cellule nucl��e, un individu porte, exprim� des milliers de fois,
une mol�cule HLA de chaque type.
Les mol�cules CMH-I constituent, pour le syst�me
immunitaire, un marqueur individuel unique appos� sur chaque cellule
de l�organisme.
Cons�quences :
- d�tection
des cellules canc�reuses o� le CMH-I est faux, � mais aussi :
- rejet
de greffe !
Affirmation
3
Non.
Un macrophage est une cellule phagocytaire, pr�sentatrice d�antig�ne aux lymphocytes T CD4.
(Et non aux Lymphocytes T CD8)
Les
diff�rences fonctionnelles sont pr�sent�es page suivante.
Affirmation
4
Si.
Comme
toutes les cellules nucl��es, un macrophage a des mol�cules CMH-I sur sa
membrane.
Page 9.
M�canisme de d�fense.
Lymphocytes T
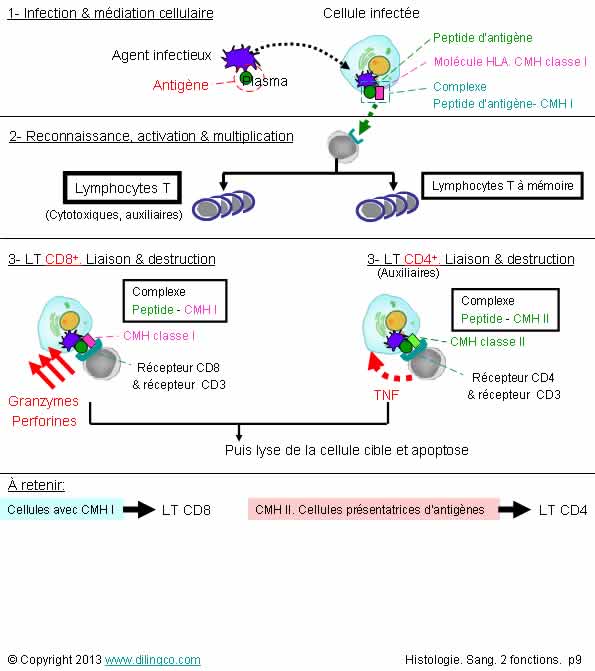
S�lectionnez
l�affirmation exacte :
1- Les
lymphocytes Tc, cytotoxiques, peuvent reconna�tre directement les antig�nes
2- Les
lymphocytes T ne peuvent qu��tre � CD4 �
3- Les
lymphocytes T CD8 et TCD4 sont capables de d�truire des cellules infect�es de
l�organisme
4- Les
co-r�cepteurs CD8 (cluster de diff�rentiation 8), sont attir�s par les
mol�cules CMH classe II
L�affirmation
3 est exacte.
Affirmation
1
Non.
Les
lymphocytes T cytotoxiques ne reconnaissent pas directement les antig�nes mais
des ensembles sp�cifiques CMH-p�ptide d�antig�ne.
Les cellules CPA sont capables de cr�er les CMH-p�ptide et de les pr�senter aux
millions de lymphocytes T.
Les cellules CPA, cellules pr�sentatrices d�antig�nes, sont :
Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique.
Affirmation
3
Oui.
Lyse cellulaire : destruction de la membrane plasmique par actions diverses : des
lysosomes (autolyse), attaques virales ou bact�riennes, action des lymphocytes,
etc.
Apoptose
Affirmation 2
Non.
Tous les lymphocytes on un marqueur CD3 plus d�autres marqueurs :
Lymphocyte T CD4
CD8 : cluster de diff�rentiation 4
Le r�cepteur CD4 est une glycoprot�ine attir�e par la
mol�cule CMH de classe II.
(Voir figure)
Lymphocyte T CD8
CD8 : cluster de diff�rentiation 8
Le r�cepteur CD8 :
- est une glycoprot�ine avec une cha�ne alpha et une cha�ne b�ta,
- est attir� par la mol�cule CMH de classe I.
(Voir figure)
Affirmation 4
Non.
Les
co-r�cepteurs CD8 (cluster de diff�rentiation 8), sont attir�s par les
mol�cules CMH classe I.
Les CD, cluster de diff�rentiation, sont des r�cepteurs
membranaires glycoprot�iniques.
Les CD
servent de marqueurs fonctionnels.
Les CD
sont aussi utiles pour trier les cellules par cytom�trie de flux.
Les CD les plus connus et utilis�s :
- CD3 : caract�rise les lymphocytes T
- CD4 : lymphocytes T Helper (auxiliaire), monocytes
Lymphocytes
T CD4 : 60% des LT
- CD8 : lymphocytes T cytotoxiques
Lymphocytes
T CD8 : 30% des LT
- CD19,
CD22,CD24 : lymphocytes B
Notes :
- Plus de
360 CD diff�rents identifi�s.
- Les
co-r�cepteurs CD8 : r�cepteur CD8 pr�sent en plus du r�cepteur CD3.
- Le VIH a une affinit� pour les lymphocytes T CD4.
Le VIH
les infectes, s�y multiplie, y bourgeonne et les tue. La d�ficience en
lymphocytes entraine une immunod�ficience.
- CD34+,
C31-, signifie que la population cellulaire exprime le CD 34 mais
pas le CD31.
TNF
membranaire :
- TNF : Facteur de n�crose tumorale (Tumor
Necrosis Factor)
- cytokine
impliqu�e dans l�inflammation.
�
CPA : Cellule pr�sentatrice d�antig�ne
(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)
CMH : Complexe majeur d�histocompatibilit�
R�gion du g�nome qui code les mol�cules HLA.
HLA : Antig�ne des leucocytes humains
(Humain
Leucocyte Ag.)
Les
mol�cules HLA, aussi appel�s � mol�cule du
CMH �,� sont � la surface de toutes les cellules.
(�
l�exception des neurones, de la corn�e, des glandes salivaires, des h�maties,
�).
Les mol�cules HLA sont sur toutes les cellules : CMH de classe I = marqueurs d�identit� d�un
individu.
HLA
suppl�mentaires sur certains leucocytes CPA :
CMH de classe II
Les CMH de type II servent de pr�sentoirs d��l�ments ext�rieurs.
Page 10.
Lymphocytes B & T

S�lectionnez
l�affirmation exacte :
1- Les PNN, PNE ne sont pas des phagocytaires
2- R�ponse immunitaire humorale : s�cr�tion d�anticorps par
les lymphocytes T
3- Les lymphocytes se forment dans la moelle osseuse rouge et
parviennent � maturation dans la moelle rouge (LB) ou le thymus (LT)
4- La destruction des pathog�nes par lyse osmotique est une
caract�ristique de l�immunit� humorale
L�affirmation 3 est exacte.
PNN :
Polynucl�aire/granulocyte neutrophile
PNE :
Polynucl�aire/granulocyte �osinophile
PNB :
Polynucl�aire/granulocyte basophile
Affirmation 1
Si.
Les PNN, PNE, Macrophages (monocytes matures) sont capables de
phagocytose.
Voir Tissu sanguin / m�canismes d�action des granulocytes et
macrophages.
�
Affirmation 2
Non.
R�ponse immunitaire humorale : s�cr�tion d�anticorps circulants
par les lymphocytes B.
D�fense de l�organisme contre les bact�ries, les virus, les toxines.
Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation
cellulaire �.
Affirmation 3
Oui.
Les lymphocytes se forment dans la moelle osseuse rouge puis
migrent dans des organes lymphatiques pour devenir matures et activables.
Page 11.
Groupes sanguins
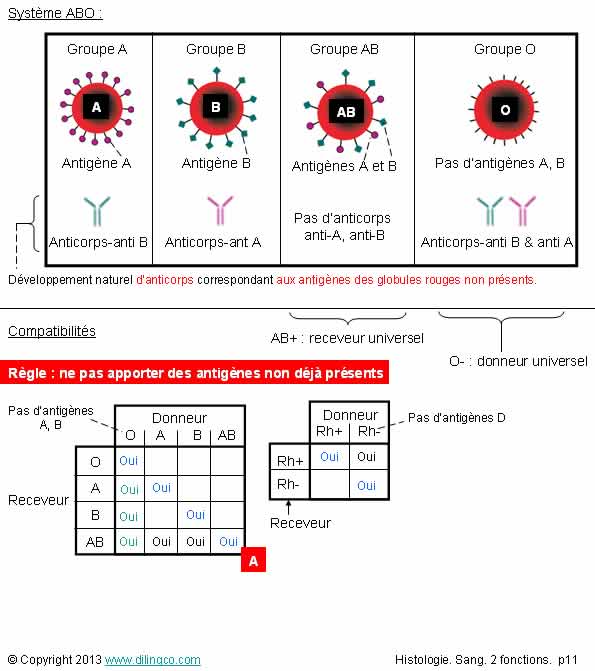
S�lectionnez
les deux affirmations exactes
1- Si un
anticorps se fixe � un antig�ne d�un globule rouge, il provoque
l�agglutination, et parfois m�me l�h�molyse, du globule rouge
2- Le
syst�me ABO est le seul syst�me qui classifie les groupes sanguins
�rythrocytaires
3- La
pr�sence d�antig�nes-A sur un GR le fait appartenir au groupe A
4-
[A] : Les personnes AB+ sont des receveurs universels
5- Les
personnes O- sont des receveurs universels
Les
affirmations 1 et 4 sont exactes.
Affirmation
1
Oui.
H�molyse :
destruction.
Affirmation
2
Non.
De nombreux syst�mes classifient les groupes sanguins li�s aux �rythrocytes (globules
rouges).
Les trois principaux syst�mes de groupes sanguins de GR :
- syst�me ABO
Entra�ne
un accident transfusionnel imm�diat si transfusion incompatible,
- syst�me Rh�sus
Incompatibilit�
de certains antig�nes.
Rh- : pas d�antig�nes D sur la membrane des globules rouges.
Rh+ : antig�nes D sur la membrane des globules rouges.
Accidents
diff�r�s. Probl�mes d�incompatibilit� f�tus/m�re.
- syst�me Kell.
M�mes probl�mes, mais moindres, que ceux d�incompatibilit� du syst�me
Rh�sus.
Note :
Des
syst�mes de groupes sanguins classifient aussi les globules blancs et les
plaquettes.
Liste des
syst�mes de groupes sanguins :
Affirmation
3
Non.
La
pr�sence d�antig�nes A sur un GR le fait appartenir au groupe A ou au groupe AB.
La
recherche des antig�nes A et B, et des anticorps pr�sents dans le s�rum,
permettent de d�finir l�appartenance � un groupe ABO.
Note :
Les
anticorps r�guliers, relatifs aux antig�nes non pr�sents sur le globule rouge,
apparaissent naturellement dans premiers mois de la vie et leur nombre se
renforce apr�s la naissance.
�
Affirmation
4
Oui.
[A] :
R�gle d�une
transfusion sanguine de GR :
Ne
transfuser que des globules rouges ayant des antig�nes d�j� pr�sents sur les
globules rouges du sujet.
En ne
consid�rant que le groupe rh�sus standard, les
personnes AB+ sont des receveurs universels de GR
(Elles ont d�j� des antig�nes A, B et D).
Affirmation
5
Non.
En ne
consid�rant que le groupe rh�sus standard, les
personnes O- sont des donneurs universels de globules rouges.
O-
n�apporte aucun des antig�nes A, B et D = donneur universel pour les syst�mes
ABO et rh�sus.
Les QCM interactifs sont accessibles � partir de la page d�accueil
du coaching virtuel � acc�s gratuit dilingco.com
Page 1.
Fonctions sanguines
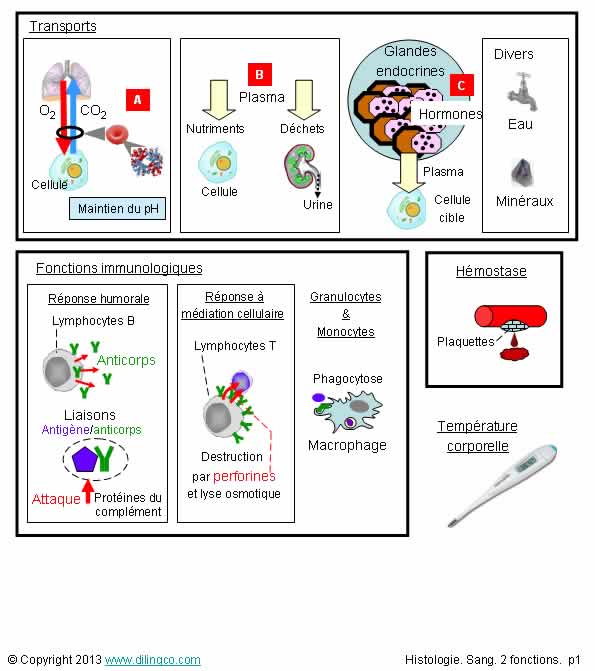
S�lectionnez les deux affirmations exactes :
1- [A] : les mol�cules d�h�moglobines des h�maties transportent de l�oxyg�ne et du gaz carbonique
2- [B] : les plaquettes transportent des nutriments ou des d�chets
3- [C] : les glandes endocrines s�cr�tent des vitamines � destination de cellules cibles ; les leucocytes transportent ces vitamines
4- Les lymphocytes sont, des 5 types de leucocytes, les seuls � avoir des fonctions immunitaires
5- H�molyse : les plaquettes bouchent les blessures et �vitent la d�perdition de sang
6- Une
baisse des GR peut traduire une an�mie; Une augmentation des PNN une infection
bact�rienne
Les affirmations 1 et 6 sont exactes.
Affirmation 2
Non.
[B] : le plasma assure le transport de certains nutriments et de certains d�chets.
Exemples :
- L�ur�e est un d�chet azot� de d�gradation des prot�ines par le foie.
Le taux d�ur�e dans l�urine compar� � l�ur�mie (taux d�ur�e dans le sang) permet de diagnostiquer des insuffisances r�nales.
- mol�cule de Cholest�rol
Affirmation 3
Non.
[C] : les glandes endocrines s�cr�tent des hormones � destination de cellules cibles.
Voir aussi :
Communications cellulaires
Vitamine
Affirmation 4
Non.
Les 5 types de cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me immunitaire : Granulocytes (neutrophiles, �osinophiles, basophiles), monocytes, lymphocytes.
Neutrophiles : cellules amibo�des phagocytaires des bact�ries et autres substances �trang�res.
�osinophiles : possibilit�s phagocytaires inf�rieures � celles des neutrophiles. Phagocytose des complexes antig�nes-anticorps.
(Voir pages ci-apr�s)
Basophiles : S�cr�tent de l�histamine et de l�h�parine pour les r�actions allergiques et inflammatoires.
Pr�curseurs des mastocytes des tissus conjonctifs.
Mastocytes :
- longue dur�e de vie et possibilit� de prolif�ration,
- r�le dans les allergies (r�actions inappropri�es).
Monocytes : pr�curseurs des macrophages.
Lymphocytes : 3 familles : lymphocytes T, lymphocytes B, lymphocytes NK. (Voir pages ci-apr�s)
Affirmation 5
Non.
H�mostase : m�canisme d�arr�t du saignement.
H�molyse : Destruction des globules rouges par la rate, le foie, la moelle.
H�matocrite : pourcentage de globules rouges par rapport au volume sanguin
H�matome : amas interne de sang par h�morragie suite � un choc, une prise de sang, etc.
�
Affirmation 6
Oui.
- Baisse des GR : an�mie ?
- Augmentation des PNN : infection bact�rienne ?
(PNN : polynucl�aires/granulocytes neutrophiles)
- Augmentation des PNEo : allergie ? Infection parasitaire ?
Exemples d�allergies : rhume des foins, asthme
(PNEo : polynucl�aires/granulocytes �osinophiles)
Augmentation des lymphocytes : infection virale ?
L�an�mie :
- se d�finit par un taux d�h�moglobine insuffisant,
- des sympt�mes tels que asth�nie (fatigue), tachycardie, p�leur, c�phal�e, vertige, etc.
An�mie
Rappels :
R�le du syst�me immunitaire
Le syst�me immunitaire est charg� de la d�fense de l�organisme contre tout �l�ment �tranger ou anormal, tels que bact�ries, virus, cellules canc�reuses, etc.
Composition
Le syst�me immunitaire est constitu� d�un ensemble complexe de mol�cules, de cellules (exemple : les leucocytes), de tissus et d�organes (rate, thymus).
Les composants du syst�me immunitaires sont reli�s entre eux par la circulation sanguine et la circulation lymphatique.
Page 2
Prot�ines & transport
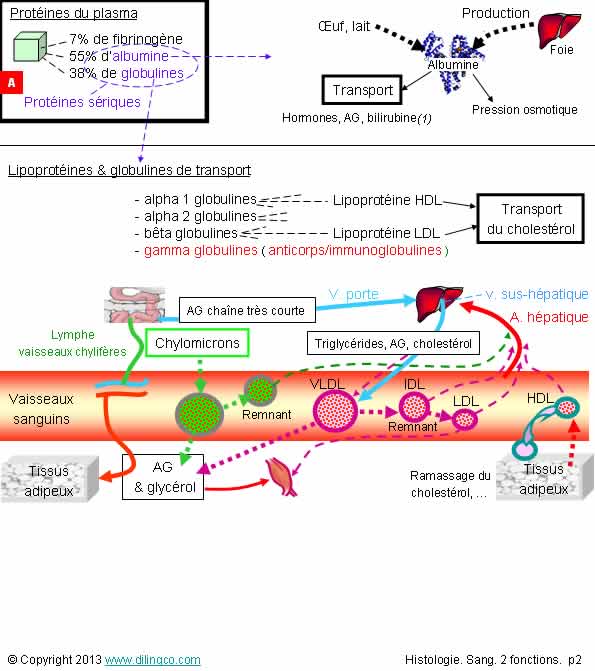
S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Le plasma ne transporte que des cellules
2- L�albumine est transport�e par les globules rouges
3- [A] : L�albumine et les globulines sont les deux types de � prot�ines s�riques �
4- L�h�moglobine et le cholest�rol sont des prot�ines s�riques
L�affirmation 3 est exacte.
Affirmation 1
Non.
Le sang transporte des cellules.
Le plasma transporte le fibrinog�ne et les �l�ments de la substance fondamentale.
Plasma sanguin : MEC, matrice extracellulaire liquide, du sang.
MEC : fibrinog�ne + substance fondamentale.
Substance fondamentale : eau, prot�ines s�riques, autres.
Autres composantes du plasma :
- Glucose,
- lipides (triglyc�rides, cholest�rol),
- substances azot�es non prot�iques (acide amin�s, ur�e et acide urique, cr�atine, bilirubine, �)
- Hormones,
- compl�ments plasmiques, cytokines,
- vitamines,
- ions (Na+, Ca2+ , K+, Cl-, �)
- O2, CO2, N,
- �
Voir aussi Composition Lec/Lic
Affirmation 2
Non.
L�albumine est une prot�ine du plasma.
L�albumine se fixe sur les acides gras, sur la bilirubine, sur certains ions m�talliques et certains m�dicaments. En s�y fixant, l�albumine assure des fonctions de transport.
Bilirubine : pigment jaune produit de d�gradation d�un globule rouge.
Accumulation anormale : jaunisse (ict�re)
Bilirubine
(Voir dans ce site la partie cin�tique de l�h�molyse, destruction, des globules rouges)
Affirmation 3
Oui.
Prot�ines s�riques : prot�ines contenues dans le s�rum.
S�rum : plasma � fibrine
Prot�ines s�riques :
- Albumine : 32 � 50 grammes par litre de s�rum
sanguin,
- Globulines :
���� �-
alpha 1 globuline : 1 � 4 g/l,
����� - alpha 2 globuline : de 5 � 11 g/l,
����� - b�taglobulines : 7 � 13 g/l,
����� - gammaglobulines : 7 � 15 g/l.
Globuline
Affirmation 4
Non.
Le cholest�rol n�est pas une prot�ine mais un st�rol, compos� � caract�re lipidique.
L�h�moglobine :
- pas une prot�ine s�rique (s�rique : prot�ine du s�rum)
- 250 millions environ de mol�cules d�h�moglobine dans les globules rouges,�
- prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine � identiques 2 � 2 (2 h�lices alpha, 141 AA, et 2 h�lices b�ta, 146 AA)
Page 3
H�moglobine
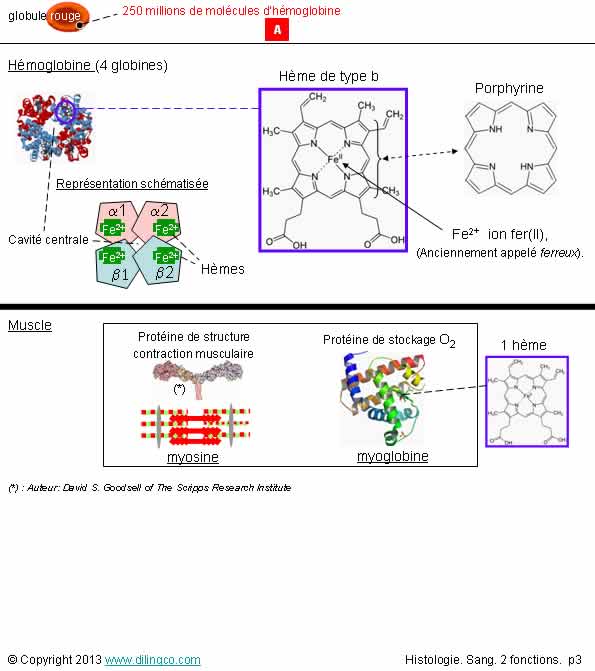
S�lectionnez les deux affirmations exactes :
1- Le plasma = �l�ments figur�s du sang
2- [A] : myoglobine
3- H�moglobine : prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine � identiques 2 � 2 (2 h�lices alpha, 141 AA, et 2 h�lices b�ta, 146 AA)
4- Chaque globine contient un h�me. Un ion fe2+ est pr�sent dans chaque h�me
5- Le globule rouge est un lymphocyte
6- Il n�y a qu�un type d�h�moglobine humaine
Les affirmations 3 et 4 sont exactes.
Affirmation 1
Non.
Le plasma est la partie liquide du sang.
Le plasma est principalement compos� d'eau.
On y trouve des substances organiques, des
d�chets, des �l�ments min�raux, des gaz dissous, des prot�ines (albumine,
lipoprot�ines, globulines), etc.
Les �l�ments figur�s du sang
sont :
- les globules rouges ou h�maties ou �rythrocytes,
- les globules blancs ou leucocytes,
- les plaquettes.
Un globule rouge contient environ 250 millions de mol�cules d�h�moglobines.
CCMH : de 32 � 36 g/100 mL.
CCMH : Concentration corpusculaire moyenne en h�moglobine
Affirmation 2
Non.
H�moglobine.
L�h�moglobine contient un h�me dans chaque une de ses quatre cha�nes. C�est un exemple d�h�t�roprot�ine � structure quaternaire.
La myoglobine, apparent�e � l�h�moglobine, est un monom�re (form�e d�une seule sous unit� compos�e de 153 acides amin�s et d�un h�me).
De part l�affinit� � l�oxyg�ne :
- L�h�moglobine est une prot�ine de transport
(Affinit� O2 variable en fonction du pH).
- La myoglobine est une prot�ine de stockage.
(Grande affinit� � l�oxyg�ne).
Affirmation 3
Oui.
L�h�moglobine est une prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine � identiques 2 � 2 (2 alpha, 141 AA, et 2 b�ta, 146 AA)
Affirmation 6
Non.
H�moglobine A. alpha2 b�ta2. La plus courante.
H�moglobine A2. alpha2 delta2. Minoritaire.
H�moglobine F. alpha2 gamma2. H�moglobine f�tale ; meilleure affinit� avec l�oxyg�ne.
Se rappeler :
Les prot�ines peuvent �tre class�es suivant leurs compositions.
Deux grands types :
Les � Holoprot�ines �, les prot�ines ne contenant que des acides amin�s.
Les � h�t�roprot�ines �, prot�ines avec :
- une partie prot�ine (l�apoprot�ine), et
- une partie non prot�ique (exemple : h�me et ion Fe2+).
Ne pas confondre :
- La myosine,
Prot�ine de structure, compos�e de deux cha�nes polypeptidiques d�environ 2000 acides amin�s. Par les modifications de sa structure, la myosine est � la base des m�canismes de contraction musculaire.
- La myoglobine,
Prot�ine globulaire des cellules musculaires, elle est apparent�e �
l�h�moglobine (la myoglobine est un monom�re alors que l�h�moglobine est un
t�tram�re).
La myoglobine est une h�t�roprot�ine contenant un h�me.
A cause de sa trop grande affinit� � l�oxyg�ne, la myoglobine n�est pas, comme l�h�moglobine, une mol�cule de transport, mais plut�t une mol�cule de stockage de l�oxyg�ne dans les muscles.
Page 4.
Fonction transport de l�h�moglobine

S�lectionnez les deux affirmations exactes :
1- H�moglobine : une prot�ine � structure quaternaire form�e de 4 cha�nes � globine � identiques 2 � 2 (2 alpha, 141 AA, et 2 b�ta, 146 AA)
2- H�moglobine : une prot�ine de stockage de l�oxyg�ne (comme la myoglobine)
3- Le pH ambiant agit sur la configuration spatiale de la mol�cule d�h�moglobine ; La configuration spatiale modifie l�affinit� � l�oxyg�ne ou au gaz carbonique
4- D�oxyh�moglobine : mol�cule d�h�moglobine charg�e en oxyg�ne
Les affirmations 1 et 3 sont exactes.
Affirmation 2
Non.
L�h�moglobine est une prot�ine de transport :
- de l�O2, ou
- du CO2 & H+
A cause
de sa trop grande affinit� � l�oxyg�ne, la
myoglobine n�est pas, comme l�h�moglobine
(affinit� O2 variable en fonction du pH), une mol�cule de transport.
La myoglobine est une mol�cule de stockage de l�oxyg�ne dans les muscles.
Texte d�explications :
Le r�le principal de l�h�moglobine est :
- le transport de l�oxyg�ne vers les tissus,
- l��vacuation des ions H+ et du CO2.
En pr�sence d'oxyg�ne, les sels ferreux (Fe2+) s'oxydent/se r�duisent rapidement en fonction du pH.
Les sels ferreux servent au transport.
Forme R, relax�e
Dans cette forme relax�e :
- La mol�cule d�h�moglobine n�est pas charg�e,
- La cavit� centrale est r�duite,
- La mol�cule d�h�moglobine a une forte affinit� pour O2
(Et faible pour CO2 et H+).
Chargement en dioxyg�ne
Figure (1)
La capture d�un O2 par une globine augmente l�affinit� des autres globines pour l�O2 : il y a interaction coop�rative entre globines et r�action en cascade acc�l�rant la capture des dioxyg�nes.
Passage de la forme R � la forme T, tendue
Figure (2)
A l�approche d�une cellule � pH bas, les h�lices alpha des globines se modifient, la cavit� centrale s�agrandie, la position spatiale du Fe par rapport au plan de l�anneau de porphyrine change.
L�affinit� de l�h�moglobine � l�oxyg�ne diminue.
Changement de chargement
Figure (3)
L�oxyg�ne est lib�r� et capt� par la cellule qui en a besoin.
Le pH de la cellule r�ceptrice d�oxyg�ne augmente ; l�h�moglobine se charge en CO2 et ions H+
Lib�ration du CO2
Figure (4)
Le CO2 de la mol�cule d�h�moglobine, alors appel�e d�oxyh�moglobine, est lib�r� dans les alv�oles pulmonaires
Voir Syst�me respiratoire.
L�h�moglobine reprend sa forme relax�e, lui permettant de se recharger en O2.
Notes :
- Le CO2 se connecte aux extr�mit�s N-terminales
des globines et il est facilement lib�rable.
- L�ion H+ se lie � des r�sidus des cha�nes prot�iques.
- En pr�sence de monoxyde de carbone
CO, l�h�moglobine se charge en CO.
Le CO se fixe sur le fer, et, avec une
affinit� beaucoup plus �lev�e que l�O2, est
difficile � d�loger = intoxication.
Page 5.
Antig�ne. Anticorps

S�lectionnez les deux affirmations exactes :
1- Un lymphocyte B n�est capable de reconna�tre qu�un seul antig�ne
2- Unicit� de reconnaissance des lymphocytes : tr�s peut d�agents infectieux peuvent �tre combattus par le syst�me immunitaire
3- Un antig�ne a un d�terminant antig�nique (un �pitope). L��pitope d�un agent infectieux d�clenche g�n�ralement une r�ponse immunitaire
4- Un anticorps est capable de reconna�tre une multitude d�antig�nes
5- Seuls les agents infectieux ont des antig�nes
6- Les cellules avec des HLA non conformes ne sont pas d�truites
Les affirmations 1 et 3 sont exactes.
Affirmation 1
Oui.
Les
lymphocytes sont sp�cialis�es pour d�tecter un d�terminent antig�nique
sp�cifique.
1 lymphocite = 1 r�cepteur = 1 �pitope.
Un �pitope :
- correspond � la partie de l�agent infectieux reconnue par un r�cepteur et un anticorps,
- peut �tre peptidique (jusqu�� une quinzaine d�AG),
- peut �tre un polysaccharide (5 � 6 sucres).
Note :
Agent infectieux, pris ici au sens large : peut �tre une cellule contamin�es, canc�reuse, une bact�rie, une toxine de bact�rie, un virus, ��
Affirmation 2
Non.
1 lymphocyte = 1 r�cepteur = 1 �pitope
Oui, mais le corps produit des centaines de milliers de types diff�rent de lymphocytes !
(Chacun sensible � un �pitope particulier)
Affirmation 3
Oui.
Antig�nes
pathog�nes : antig�nes de bact�ries ou de toxines, de virus, de cellules
canc�reuses.
Toxine : mol�cule toxique fabriqu�e par une
bact�rie pathog�ne.
Exemples : toxine botulique, t�tanique, chol�rique, dipht�rique, etc.
Affirmation 4
Non.
1 anticorps reconna�t 1 antig�ne
Affirmation 5
Non.
Antig�nes :
- pr�sents sur les membranes des cellules de l�organisme et sur les agents infectieux,
- macromol�cules reconnues par le r�cepteur d�une cellule immunitaire ou par un anticorps,
- sont des prot�ines, des polysaccharides et les d�riv�s lipidiques,
- peuvent �tre pathog�nes, provoquer des r�actions immunitaires et �tre responsables de maladies.
- 2 classes d�antig�nes.
Antig�nes classe 1
- antig�nes pr�sents sur les membranes de toutes les cellules de
l�organisme, �
l�exception des cellules germinales.
- antig�nes appel�s HLA, mol�cules du CMH
HLA : Antig�nes des leucocytes humains (HLA),
CMH : Complexe� majeur d�histocompatibilit�.
- Les globules rouges ont des marqueurs mineurs, les agglutinog�nes.
Antig�nes classe 2
Antig�nes suppl�mentaires pr�sents sur les membranes des cellules immunitaires CPA, Cellule pr�sentatrice d�antig�ne
(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)
Note :
Agent infectieux, pris ici au sens large : peut �tre une cellule contamin�es, canc�reuse, une bact�rie, une toxine de bact�rie, un virus, ��
Affirmation 6
Si.
Le syst�me immunitaire utilise le HLA, empreinte unique par individu, appos� sur toutes les cellules d�un individu, pour distinguer les cellules �trang�res, non conformes, et les d�truire.
Rappel. Cellules immunitaires
Leucocytes (ou globules blancs)
- Famille de cellules du syst�me immunitaire.
- Produites dans la moelle osseuses.
-
Pr�sents dans le sang, la lymphe, les organes lympho�des, et de nombreux tissus
conjonctifs.
Organes lympho�des : Ganglions, rate, amygdale et v�g�tations, plaques de
Peyer).
Voir : Trajet des leucocytes
Les cellules leucocytes du syst�me immunitaire :
Granulocytes, monocytes, lymphocytes.
Pourcentages :
Granulocytes
��� Neutrophiles, de 50 � 70 %
��� Eosinophiles, de 2 � 4 %
��� Basophiles, de 0,5 � 1 %
Lymphocytes, de 20 � 40 %
Monocytes, de 3 � 8 %
Granulocytes
- Leucocytes, globules blancs � non sp�cifique � (non d�di� � un antig�ne sp�cifique).
- Tr�s nombreuses granules dans le cytoplasme.
- Granulocytes neutrophiles, basophiles, �osinophiles
(Le nom est li� � leur affinit� � un colorant neutre, basique, ou �osine)
- Neutrophiles : phagocytes.
- Basophiles : d�versent de l�histamine pour attirer les autres globules blancs.
- �osinophiles : d�versent des enzymes sur les parasites.
Monocytes
Les monocytes sont des cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me immunitaire.
- Plus grosses cellules qui circulent dans le sang,
- Cellules mobiles,
- Phagocytes : macrophages dans les tissus conjonctifs, microglycocytes dans le SNC, ost�oclastes dans l�os.
Lymphocytes
Les lymphocytes sont des cellules leucocytes (ou globules blancs) du syst�me immunitaire.
2 lign�es : lymphocytes T et lymphocytes B.
Lymphocytes T :
- Leur d�veloppement s�ach�ve dans le thymus,
- Lymphocytes cytotoxiques (d�truisent les cellules infect�es),
- Lymphocytes auxiliaires,
- Lymphocytes suppresseurs.
�rythrocytes (H�maties, ou globules rouges)
- Cellule d�pourvue de noyau (anucl��),
- cytoplasme riche en h�moglobine,
- assure le transport O2 et CO2
Thrombocytes (Plaquettes)
R�le important pour la coagulation sanguine.
Mastocytes
- Cellules normalement pr�sentes dans les tissus conjonctifs (et non dans le sang),
- Tr�s nombreuses granules dans le cytoplasme.
- Les granules contiennent des m�diateurs chimiques comme la s�rotonine, l�histamine, la tryptase ou l�h�parine.
- Les granules sont lib�r�es au contact d�un allerg�ne.
Plasmocytes
- Cellules normalement pr�sentes dans les tissus conjonctifs (et non dans le sang),
- Globules blancs.
Page 6.
M�canisme de d�fense. Lymphocytes B

S�lectionnez les deux affirmations exactes :
1- [A] : Un r�cepteur de lymphocyte B n�est pas sp�cifique � un d�terminant antig�nique particulier
2- Apr�s reconnaissance d�un antig�ne, les lymphocytes B se diff�rentient en plasmocytes et en lymphocytes B � m�moire
3- Lymphocytes B : lib�rent les immunoglobulines solubles dans l�environnement qui d�truisent directement les agents infectieux
4- Une fois activ�, un lymphocyte B se diff�rentie en lymphocyte T
5- Lymphocytes B : r�ponse immunitaire humorale (reconnaissance directe du pathog�ne, s�cr�tion d�anticorps, actions destructives par les anticorps, �
Les affirmations 2 et 5 sont exactes.
Affirmation 1
Si.
[A] : Le r�cepteur LB est sp�cifique � un d�terminant antig�nique particulier.
1 lymphocyte B = 1 r�cepteur BCR = 1 �pitope = 1 antig�ne.
(Epitope = d�terminant antig�nique)
Affirmation 2
Oui.
Les lymphocytes � m�moires permettent � l�organisme d�avoir une r�ponse beaucoup plus rapide et plus durable si l�agent pathog�ne se repr�sente.
Ils ont une dur�e de vie plus longue que les plasmocytes.
Affirmation 3
Non.
Ce sont les Plasmocytes qui lib�rent les immunoglobulines (les anticorps).
Plasmocytes : diff�rentiation finale des lymphocytes B.
Ce ne sont pas les immunoglobulines (les anticorps) qui d�truisent les agents infectieux.
Affirmation 5
Oui.
Lymphocyte B : � r�ponse humorale �. Lib�ration d�anticorps,
ou immunoglobulines, par les plasmocytes.�
Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation cellulaire �.
Page 7.
CMH. CPA
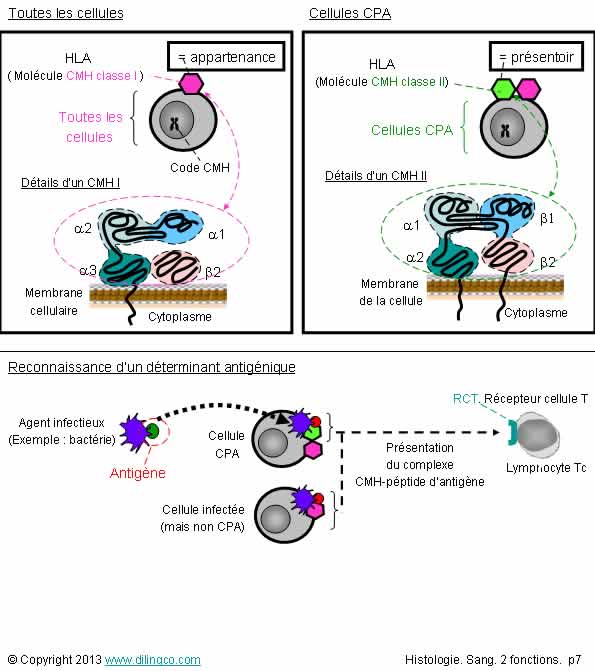
S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Les lymphocytes Tc, cytotoxiques, peuvent reconna�tre directement les antig�nes
2- La mol�cule CMH classe I est une prot�ine compos�e d�une cha�ne alpha et d�une b�ta 2
3- La mol�cule CMH classe I, � Complexe majeur d�histocompatibilit� �, n�est pas impliqu�e dans les ph�nom�nes de rejets de greffes
4- Seules les cellules CPA peuvent pr�senter un complexe CMH-peptide d�antig�ne aux lymphocytes T
L�affirmation 2 est exacte.
Affirmation 1
Non.
Les antig�nes doivent leur �tre pr�sent�s dans un ensemble CMH-p�ptide d�antig�ne pour �tre reconnus par les lymphocytes Tc.
Les antig�nes doivent �tre retravaill�s pour donner un peptide sp�cifique. Ce peptide s�associe � la prot�ine CMH pour que l�ensemble soit reconnu par une des millions de lymphocytes T.
Affirmation 4
Non.
A
l�exception des cellules germinales, toutes les cellules ont des mol�cules CMH
sur leur membrane.
Les cellules CPA, cellules
� professionnelles � de la pr�sentation immunitaire, ont en plus des mol�cules CMH classe II.
Les lymphocytes peuvent d�tecter :
- des complexes CMH-peptides d�antig�ne anormaux,
- des CMH I d�t�rior�s ou n�appartenant pas � l�organisme de l�individu
(Exemple : cellule canc�reuse).
Lymphocyte B : � r�ponse humorale �. Lib�ration d�anticorps ou
immunoglobulines par les plasmocytes.�
Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation cellulaire �.
CPA : Cellule pr�sentatrice d�antig�ne
(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)
CMH : Complexe majeur d�histocompatibilit�
R�gion du g�nome qui code les mol�cules HLA connues.
HLA : Antig�ne des leucocytes humains
(Humain Leucocyte Ag.)
Les mol�cules HLA, aussi appel�s � mol�cule du CMH �,� sont � la surface de toutes les cellules.
(�
l�exception des neurones, de la corn�e, des glandes salivaires, des h�maties,
�).
Les mol�cules HLA sont sur toutes les cellules :
CMH de classe I = marqueurs d�identit� d�un individu.
HLA suppl�mentaires sur certains leucocytes : CMH de classe II
Les CMH de type II servent de pr�sentoirs d��l�ments ext�rieurs.
Page 8.
Pr�sentation aux lymphocytes T
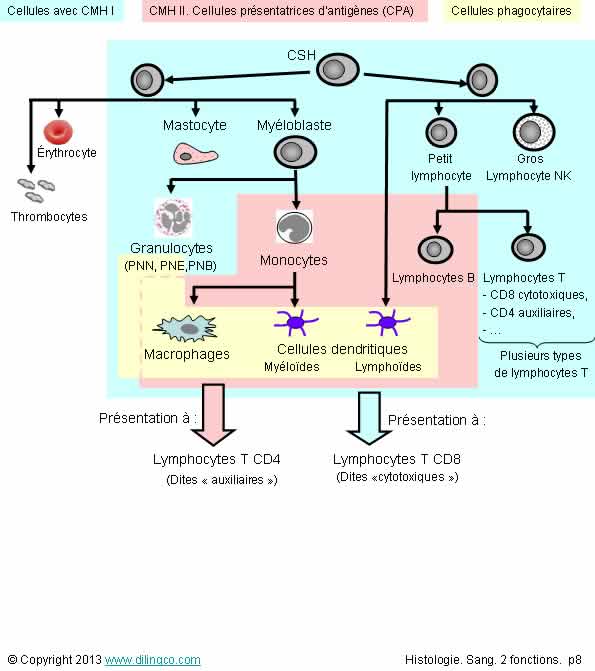
S�lectionnez les deux affirmations exactes :
1- Les mol�cules du CMH-I sont pr�sentes sur toutes les membranes des cellules nucl��es
2- La membrane d�une cellule nucl��e ne porte qu�une seule mol�cule CMH-I
3- Un macrophage est une cellule phagocytaire, pr�sentatrice d�antig�ne aux lymphocytes T CD8
4- Un macrophage n�a pas de mol�cule CMH-I
5- Les lymphocytes B peuvent reconna�tre directement les pathog�nes et agir en cons�quence. Les lymphocytes B sont aussi des cellules pr�sentatrices d�antig�nes
Les affirmations 1 et 5 sont exactes.
Affirmation 1
Oui.
Donc les mol�cules du CMH-I ne sont pas pr�sentes sur les membranes des globules rouges.
Affirmation 2
Non.
6 types
de mol�cules CMH-I (2 mol�cules HLA-A, 2 mol�cules HLA-B et 2 HLA-C).
Pour chaque cellule nucl��e, un individu porte, exprim� des milliers de fois,
une mol�cule HLA de chaque type.
Les mol�cules CMH-I constituent, pour le syst�me
immunitaire, un marqueur individuel unique appos� sur chaque cellule
de l�organisme.
Cons�quences :
- d�tection des cellules canc�reuses o� le CMH-I est faux, � mais aussi :
- rejet de greffe !
Affirmation 3
Non.
Un macrophage est une cellule phagocytaire, pr�sentatrice d�antig�ne aux lymphocytes T CD4.
(Et non aux Lymphocytes T CD8)
Les
diff�rences fonctionnelles sont pr�sent�es page suivante.
Affirmation 4
Si.
Comme
toutes les cellules nucl��es, un macrophage a des mol�cules CMH-I sur sa
membrane.
Page 9.
M�canisme de d�fense. Lymphocytes T
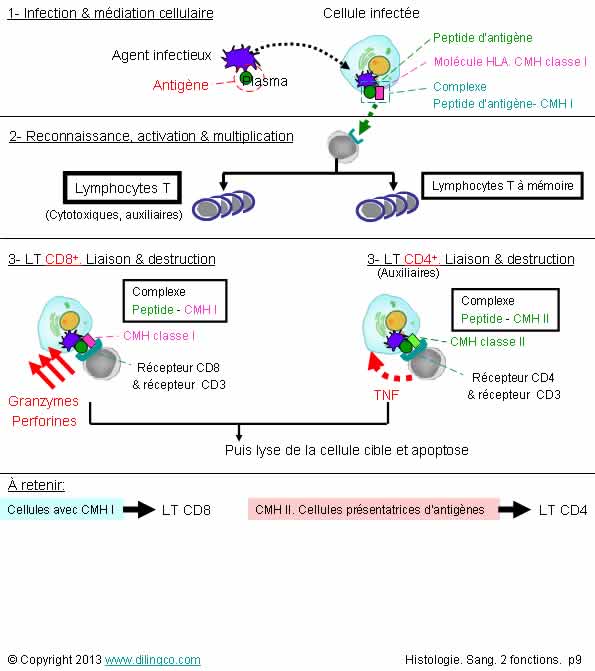
S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Les lymphocytes Tc, cytotoxiques, peuvent reconna�tre directement les antig�nes
2- Les lymphocytes T ne peuvent qu��tre � CD4 �
3- Les lymphocytes T CD8 et TCD4 sont capables de d�truire des cellules infect�es de l�organisme
4- Les co-r�cepteurs CD8 (cluster de diff�rentiation 8), sont attir�s par les mol�cules CMH classe II
L�affirmation 3 est exacte.
Affirmation 1
Non.
Les
lymphocytes T cytotoxiques ne reconnaissent pas directement les antig�nes mais
des ensembles sp�cifiques CMH-p�ptide d�antig�ne.
Les cellules CPA sont capables de cr�er les CMH-p�ptide et de les pr�senter aux
millions de lymphocytes T.
Les cellules CPA, cellules pr�sentatrices d�antig�nes, sont :
Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique.
Affirmation 3
Oui.
Lyse cellulaire : destruction de la membrane plasmique par actions diverses : des lysosomes (autolyse), attaques virales ou bact�riennes, action des lymphocytes, etc.
Apoptose
Affirmation 2
Non.
Tous les lymphocytes on un marqueur CD3 plus d�autres marqueurs :
Lymphocyte T CD4
CD8 : cluster de diff�rentiation 4
Le r�cepteur CD4 est une glycoprot�ine attir�e par la mol�cule CMH de classe II.
(Voir figure)
Lymphocyte T CD8
CD8 : cluster de diff�rentiation 8
Le r�cepteur CD8 :
- est une glycoprot�ine avec une cha�ne alpha et une cha�ne b�ta,
- est attir� par la mol�cule CMH de classe I.
(Voir figure)
Affirmation 4
Non.
Les co-r�cepteurs CD8 (cluster de diff�rentiation 8), sont attir�s par les mol�cules CMH classe I.
Les CD, cluster de diff�rentiation, sont des r�cepteurs membranaires glycoprot�iniques.
Les CD servent de marqueurs fonctionnels.
Les CD sont aussi utiles pour trier les cellules par cytom�trie de flux.
Les CD les plus connus et utilis�s :
- CD3 : caract�rise les lymphocytes T
- CD4 : lymphocytes T Helper (auxiliaire), monocytes
Lymphocytes T CD4 : 60% des LT
- CD8 : lymphocytes T cytotoxiques
Lymphocytes T CD8 : 30% des LT
- CD19, CD22,CD24 : lymphocytes B
Notes :
- Plus de 360 CD diff�rents identifi�s.
- Les co-r�cepteurs CD8 : r�cepteur CD8 pr�sent en plus du r�cepteur CD3.
- Le VIH a une affinit� pour les lymphocytes T CD4.
Le VIH les infectes, s�y multiplie, y bourgeonne et les tue. La d�ficience en lymphocytes entraine une immunod�ficience.
- CD34+, C31-, signifie que la population cellulaire exprime le CD 34 mais pas le CD31.
TNF membranaire :
- TNF : Facteur de n�crose tumorale (Tumor Necrosis Factor)
- cytokine impliqu�e dans l�inflammation.
�
CPA : Cellule pr�sentatrice d�antig�ne
(Monocyte, macrophage, lymphocyte B, cellule dendritique)
CMH : Complexe majeur d�histocompatibilit�
R�gion du g�nome qui code les mol�cules HLA.
HLA : Antig�ne des leucocytes humains
(Humain Leucocyte Ag.)
Les mol�cules HLA, aussi appel�s � mol�cule du CMH �,� sont � la surface de toutes les cellules.
(�
l�exception des neurones, de la corn�e, des glandes salivaires, des h�maties,
�).
Les mol�cules HLA sont sur toutes les cellules : CMH de classe I = marqueurs d�identit� d�un
individu.
HLA suppl�mentaires sur certains leucocytes CPA : CMH de classe II
Les CMH de type II servent de pr�sentoirs d��l�ments ext�rieurs.
Page 10.
Lymphocytes B & T

S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Les PNN, PNE ne sont pas des phagocytaires
2- R�ponse immunitaire humorale : s�cr�tion d�anticorps par les lymphocytes T
3- Les lymphocytes se forment dans la moelle osseuse rouge et parviennent � maturation dans la moelle rouge (LB) ou le thymus (LT)
4- La destruction des pathog�nes par lyse osmotique est une caract�ristique de l�immunit� humorale
L�affirmation 3 est exacte.
PNN : Polynucl�aire/granulocyte neutrophile
PNE : Polynucl�aire/granulocyte �osinophile
PNB : Polynucl�aire/granulocyte basophile
Affirmation 1
Si.
Les PNN, PNE, Macrophages (monocytes matures) sont capables de phagocytose.
Voir Tissu sanguin / m�canismes d�action des granulocytes et macrophages.
�
Affirmation 2
Non.
R�ponse immunitaire humorale : s�cr�tion d�anticorps circulants par les lymphocytes B.
D�fense de l�organisme contre les bact�ries, les virus, les toxines.
Lymphocytes T : � r�ponse � m�diation cellulaire �.
Affirmation 3
Oui.
Les lymphocytes se forment dans la moelle osseuse rouge puis migrent dans des organes lymphatiques pour devenir matures et activables.
Page 11.
Groupes sanguins
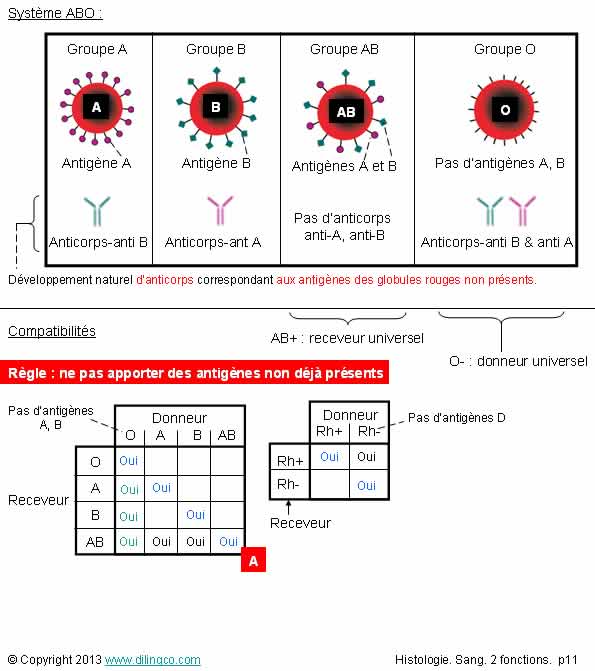
S�lectionnez les deux affirmations exactes
1- Si un anticorps se fixe � un antig�ne d�un globule rouge, il provoque l�agglutination, et parfois m�me l�h�molyse, du globule rouge
2- Le syst�me ABO est le seul syst�me qui classifie les groupes sanguins �rythrocytaires
3- La pr�sence d�antig�nes-A sur un GR le fait appartenir au groupe A
4- [A] : Les personnes AB+ sont des receveurs universels
5- Les personnes O- sont des receveurs universels
Les affirmations 1 et 4 sont exactes.
Affirmation 1
Oui.
H�molyse : destruction.
Affirmation 2
Non.
De nombreux syst�mes classifient les groupes sanguins li�s aux �rythrocytes (globules
rouges).
Les trois principaux syst�mes de groupes sanguins de GR :
- syst�me ABO
Entra�ne un accident transfusionnel imm�diat si transfusion incompatible,
- syst�me Rh�sus
Incompatibilit� de certains antig�nes.
Rh- : pas d�antig�nes D sur la membrane des globules rouges.
Rh+ : antig�nes D sur la membrane des globules rouges.
Accidents diff�r�s. Probl�mes d�incompatibilit� f�tus/m�re.
- syst�me Kell.
M�mes probl�mes, mais moindres, que ceux d�incompatibilit� du syst�me
Rh�sus.
Note :
Des syst�mes de groupes sanguins classifient aussi les globules blancs et les plaquettes.
Liste des syst�mes de groupes sanguins :
Affirmation 3
Non.
La pr�sence d�antig�nes A sur un GR le fait appartenir au groupe A ou au groupe AB.
La recherche des antig�nes A et B, et des anticorps pr�sents dans le s�rum, permettent de d�finir l�appartenance � un groupe ABO.
Note :
Les anticorps r�guliers, relatifs aux antig�nes non pr�sents sur le globule rouge, apparaissent naturellement dans premiers mois de la vie et leur nombre se renforce apr�s la naissance.
�
Affirmation 4
Oui.
[A] :
R�gle d�une transfusion sanguine de GR :
Ne transfuser que des globules rouges ayant des antig�nes d�j� pr�sents sur les globules rouges du sujet.
En ne consid�rant que le groupe rh�sus standard, les personnes AB+ sont des receveurs universels de GR
(Elles ont d�j� des antig�nes A, B et D).
Affirmation 5
Non.
En ne consid�rant que le groupe rh�sus standard, les personnes O- sont des donneurs universels de globules rouges.
O- n�apporte aucun des antig�nes A, B et D = donneur universel pour les syst�mes ABO et rh�sus.