Les QCM interactifs sont accessibles � partir de la page d�accueil
du coaching virtuel � acc�s gratuit dilingco.com
Ensembles fonctionnels

S�lectionnez les deux affirmations exactes :
1- [A] : choro�de
2- [B] : oreille interne
3- Les ondes sonores (qui se propagent m�me dans le vide),
arrivent aux cellules cili�es qui les retransmettent aux nerfs auditifs
4- Transmission des vibrations : tympan, marteau, enclume,
�trier, appareil vestibulaire, cochl�e, pour �tre d�tect�es par les cellules
cili�es
5- Deux petits muscles dans l�oreille moyenne : le tenseur du
tympan, le muscle stap�tien.
�
Les affirmations 4 et 5 sont exactes.
Affirmation 1
Non.
[A] : Membrane tympanique.
La choro�de est l�enveloppe fibreuse de l��il.
Affirmation 2
Non.
[B] : oreille moyenne.
L�oreille moyenne comprend : le tympan, la caisse du tympan,
la trompe d�Eustache.
Affirmation 3
Non.
Les ondes sonores :
- sont des vibrations des mol�cules d�un milieu (air, eau,�),
- ne se propagent pas dans le vide,
- arrivent aux cellules cili�es qui les d�tectent, par les
vibrations de leurs cils, et les transforment en potentiel d�action
PA
Affirmation 4
Oui.
Le marteau, l�enclume, l��trier sont de tr�s petits os.
Affirmation 5
Oui.
Muscle tenseur du tympan : figure (1)
Muscle stap�tien : figure (2).
R�flexe stap�dien :
Att�nuation de l�intensit� sonore transmise � l�oreille
interne par contraction du muscle de l��trier.
Stapia : �trier en latin
Page 2.
Oreille. Vue d�ensemble
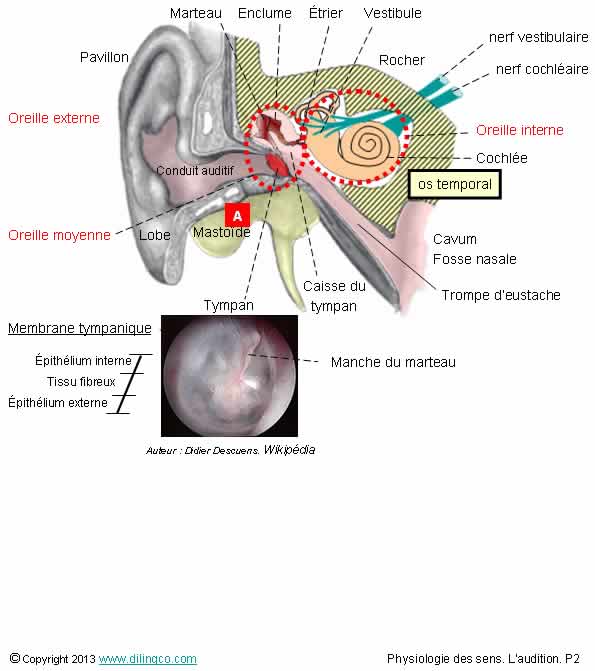
S�lectionnez
les deux affirmations exactes :
1-
L�oreille ne communique pas avec la fosse nasale
2- Trois
osselets de la caisse tympanique : le marteau, l�enclume, l��trier
3- Les
vibrations m�caniques font vibrer les nerfs auditifs et le cerveau
4- Toit
osseux de l�oreille moyenne et interne = rocher de l�os temporal
5- Toit
osseux de l�oreille moyenne et interne = processus masto�de
6- Le
m�at acoustique interne se trouve dans la partie tympanique de l�os pari�tal
7-
[A] : L�oreille moyenne ne communique pas avec les cellules masto�diennes
Les
affirmations 2 et 4 sont exactes.
Affirmation
1
Si.
L�oreille
communique avec le cavum/fosse nasale par la
trompe d�eustache.
Raisons :
- ventilation
de l�oreille moyenne,
- r�gulation des pressions n�cessaire � la
mobilit� du tympan,
(Encombrement
de la trompe d�Eustache, rhume = diminution des capacit�s auditives)
- �viter la rupture du tympan suite � des variations brusques
de pression.
Affirmation
2
Oui.
Le marteau transmet les vibrations de la membrane du tympan � l��trier par l�interm�diaire de l�enclume.
L�oreille
moyenne assure l�amplification/limitation (r�flexe
stap�dien) des sons pour les transmettre au milieu liquide de
l�oreille interne.
Affirmation
3
Non, pas
directement.
Les ondes sonores sont traduites en ondes �lectriques (Potentiel
d�action).
Le PA est transmis au cortex auditif.
Affirmation
5
Non.
Les
cavit�s de l�oreille moyenne et interne sont dans l�os temporal.
Le rocher
(os p�treux) constitue la partie sup�rieure de l�oreille interne.
Affirmation
6
Non.
Le m�at acoustique interne se trouve dans la partie p�treuse de l�os temporal.
L�os
temporal est form� de trois parties soud�es :
-
L��caille,
- La
partie tympanique
- Le rocher (ou partie p�treuse/os p�treux).
Affirmation
7
Si.
[A] :
L�oreille moyenne communique avec les cellules masto�diennes
Une otite (inflammation de la peau ou de la muqueuse de l�oreille),
peut s��tendre aux cellules masto�dienne (masto�dite).
Page 3.
Le son
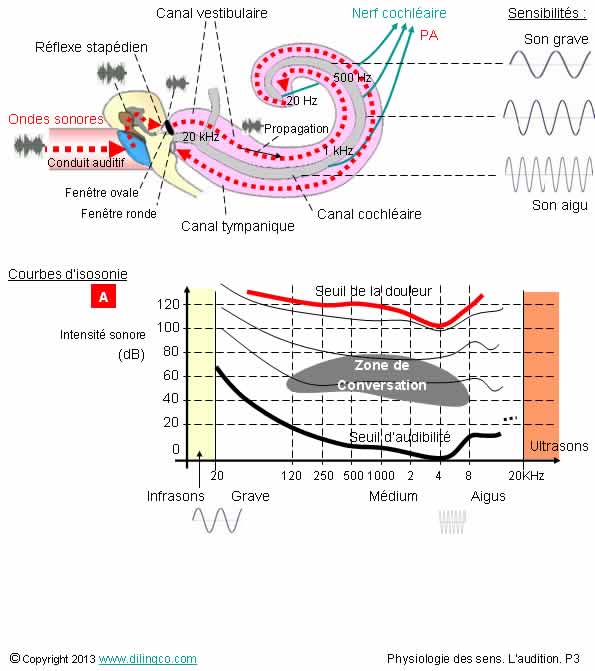
S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- L�oreille humaine peut percevoir les infrasons et les ultrasons
2- Les ondes sonores se propagent dans le vide
3- [A] : Les courbes d�isosonie (courbes d��gale sensation),
montrent que la sensibilit� de l�oreille ne d�pend pas des caract�ristiques du
son
4- Les lieux de r�sonance (vibrations maximales) sont r�partis, en
fonction des fr�quences soniques (auteur du son), sur la longueur de la cochl�e
L�affirmation 4 est exacte.
Affirmation 1
Non.
Sensibilit� de l�oreille interne : 20 � 20 000 Hz
(22 000 Hz pour les femmes).
Zones de meilleure sensibilit� : 1000 � 4000 Hz.
Les sons tr�s aigus ne sont plus per�us par les personnes �g�es.
Les ultrasons, sons tr�s aigus, sont per�us par les chiens, les
chauves-souris, �
Les infrasons, sons tr�s graves, sont per�us par les �l�phants, �
Affirmation 2
Non.
Ne pas confondre les ondes sonores avec les ondes �lectromagn�tiques.
Les ondes �lectromagn�tiques se propagent dans le vide.
Les ondes sonores sont les vibrations m�caniques d�un milieu.
L��lasticit� du milieu a un r�le dans la propagation sonore :
-� 340 m/s dans l�air.
- moins de pertes, meilleure propagation, dans l�eau que dans
l�air,
- Les solides transmettent mieux encore les ondes sonores
(Lucky Luc, son oreille et le rail de chemin de fer).
Affirmation 3
Si.
Les courbes d�isosonie montrent que la sensation auditive d�pend
des caract�ristiques du son :
- sensibilit� diminu�e aux basses fr�quences,
- la sensibilit� aux bruits forts varie moins que celle aux bruits
faibles.
R�flexe stap�dien :
Att�nuation de l�intensit� sonore transmise � l�oreille
interne par contraction des muscles de l��trier
Stapia : �trier en latin
Page 4.
Labyrinthes osseux &
membraneux
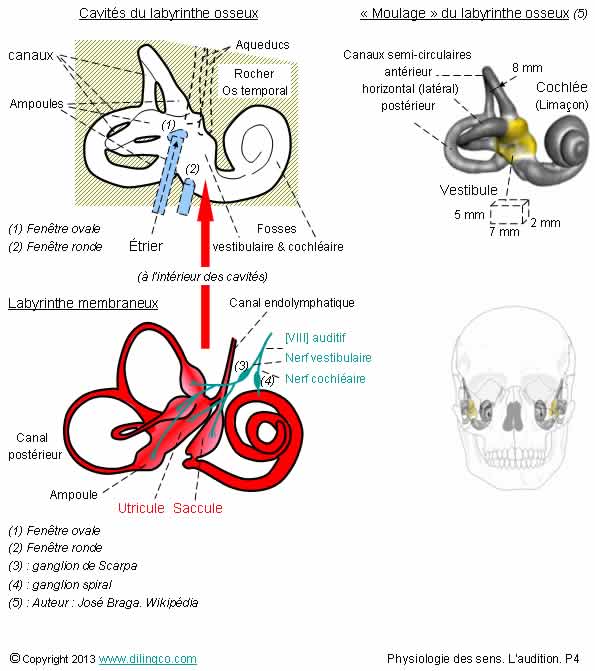
S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Le labyrinthe membraneux est dans l�oreille moyenne ; le
labyrinthe osseux dans l�oreille interne
2- Le labyrinthe osseux, ensembles de cavit�s du rocher de l�os
temporal, contient le labyrinthe membraneux
L�affirmation 2 est exacte.
Oreille interne :
Page 5.
Labyrinthe membraneux

S�lectionnez les deux affirmations exactes :
1- Organe de l��quilibre : la cochl�e. Organe de
l�audition : le vestibule
2- Le vestibule membraneux : utricule + saccule + 3 canaux
semi-circulaires situ�s dans 3 plans perpendiculaires
3- Les 3 canaux (ou rampes) du lima�on : le canal
vestibulaire, le canal tympanique, le canal cochl�aire
4- Les trois canaux sont reli�s entre eux par l�h�licotr�me, orifice
situ� � l�apex du labyrinthe membraneux
5- La fen�tre ovale, qui vibre � la fr�quence de l��trier, est �
l�entr�e de la rampe tympanique
6- L�endolymphe est le liquide qui se trouve dans le canal
vestibulaire et le canal tympanique
Les affirmations 2 et 3 sont exactes.
Affirmation 1
Non.
Organe de l��quilibre : le vestibule.
Le vestibule est impliqu� dans la maladie de M�ni�re.
Organe de l�audition : la cochl�e.
(Ou lima�on, ou labyrinthe membraneux)
Affirmation 2
Oui.
Les r�cepteurs vestibulaires des canaux, situ�s dans trois plans
perpendiculaires, sont sensibles � la position de la t�te, aux acc�l�rations
(Tourner sur soi-m�mes, man�ges, �).
Le vestibule membraneux peut �tre compar� � une centrale � inertie.
Le mouvement, les acc�l�rations, du liquide interne (l�endolymphe), n�ont pas les m�mes
effets sur des cellules r�ceptrices r�parties sur des axes orthogonaux.
Affirmation4
Non.
Seul le canal vestibulaire est reli� au canal tympanique.
Page 6.
R�ception des sons
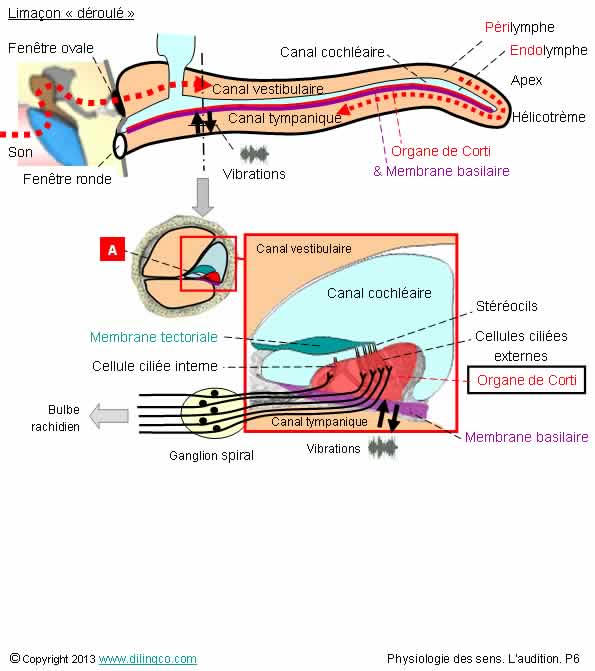
S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- La propagation d�un son dans le canal tympanique provoque des
pressions identiques des deux c�t�s de la membrane basilaire
2- L�organe de Corti est une bande sensorielle h�lico�dale support�e
par une membrane flexible, la membrane basilaire
3- Les noyaux des neurones reli�s aux cellules sensitives sont
dans l�organe de Corti
4- [A] : ganglion spiral
L�affirmation 2 est exacte.
Affirmation 1
Non.
La propagation d�un son dans le canal tympanique provoque des �carts
de pressions entre le canal tympanique et le canal cochl�aire.
La membrane basilaire et l�organe de Corti vibrent au rythme de
ces variations de pressions.
Les cellules cili�es de l�organe de Corti g�n�rent, par le
frottement des st�r�ocils sur la membrane tectoriale, des potentiels d�action
en direction du cortex auditif.
Affirmation 3
Non.
Neurones reli�s aux cellules sensitives de l�organe de Corti :
- noyaux situ�s dans les ganglions spiraux
(Voir page pr�c�dente).
- neurones bipolaires,
- les axones de ces neurones se regroupent pour constituer le nerf
cochl�aire puis le nerf vestibulo-cochl�aire ; nerf auditif [VIII].
Page 7.
Transduction Son / PA

S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Il y a plus de cellules cili�es internes que de cellules
cili�es externes
2- Les st�r�ocils des cellules cili�es internes n�entrent en
contact avec la membrane tectoriale que si l�intensit� sonore est suffisante
L�affirmation 2 est exacte.
Affirmation 1
Non.
Il y a environ trois fois plus de cellules cili�es externes que de
cellules cili�es internes.
(12500 CCE contre 3500 CCI environ)
Les cellules cili�es internes sont rang�es sur une ligne.
�
Affirmation 2
Oui.
Le contact des st�r�ocils CCI avec la membrane tectoriale ne
s��tablit que si le son est sup�rieur � 50 dB.
PA : Potentiel d�action
Page 8.
PA� cochl�aires

S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Stimulation sonore = diminution du nombre de PA dans les fibres
nerveuses auditives
2- Les cellules cili�es sont des neurones
3- Plus le son est fort, plus la fr�quence d��mission de PA est
�lev�e
4- Le potassium provient des canaux vestibulaires &
tympaniques. Il est s�cr�t� par les cellules de la membrane basilaire
L�affirmation 3 est exacte.
�
Affirmation 1
Non.
Stimulation sonore = augmentation du nombre de PA.
Affirmation 4
Non.
Le potassium provient de l�endolympe du canal cochl�aire.
Il y est s�cr�t� par les cellules des stries vasculaires.
Voir page pr�c�dente.
La compression des ponts prot�iques par les st�r�ocils ouvre
les canaux ioniques au potassium.
Le cycle des r�actions en cha�nes (figure : 1, 2, 3, 4) va se
poursuivre tant que les st�r�ocils compriment les ponts prot�iques.
�
Voir aussi :
Neurotransmetteurs
Concentrations LEC/LIC
Canaux / Tansporteurs / Pompes
Potentiel d�action. PA
Page 9.
Voies auditives
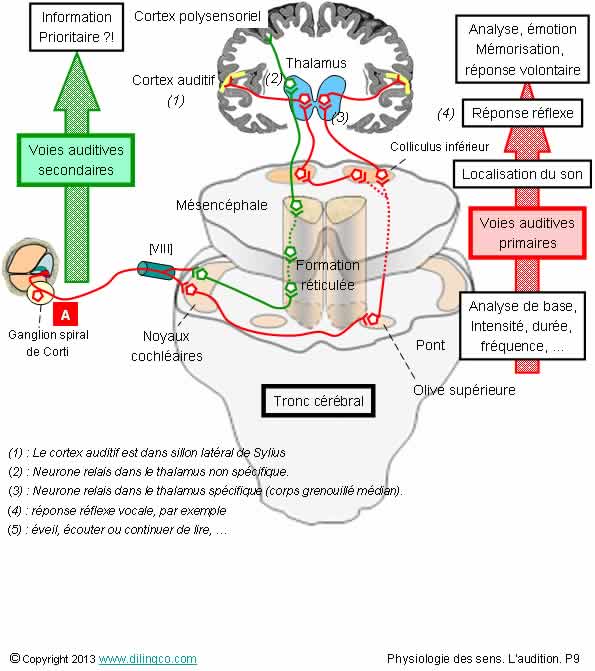
S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Les r�flexes d�orientation li�s � la localisation d�un son sont
du ressort du cortex auditif
2- La formation r�ticul�e du tronc c�r�bral ne contient que les
relais neuronaux propres aux sensations auditives
3- [A] : Cochl�e & neurones sensoriel primaire du ganglion
spiral. [VIII] : nerf vestibulo-cochl�aire (nerf auditif)
4- Les sons sont capt�s par les deux oreilles mais il n�y a qu�une
seule voie auditive et seul le cortex auditif droit est actif
�
L�affirmation 3 est exacte.
Affirmation 1
Non.
Les r�flexes d�orientation li�s � la localisation : colliculus
inf�rieur.
Affirmation 2
Non.
La formation r�ticul�e :
- s��tire sur toute la longueur du tronc c�r�bral,
- ses neurones participent � des fonctions motrices/autonomes
(R�gulation de la marche, veille/sommeil, r�flexes, �)
Les QCM interactifs sont accessibles � partir de la page d�accueil
du coaching virtuel � acc�s gratuit dilingco.com
Ensembles fonctionnels

S�lectionnez les deux affirmations exactes :
1- [A] : choro�de
2- [B] : oreille interne
3- Les ondes sonores (qui se propagent m�me dans le vide), arrivent aux cellules cili�es qui les retransmettent aux nerfs auditifs
4- Transmission des vibrations : tympan, marteau, enclume, �trier, appareil vestibulaire, cochl�e, pour �tre d�tect�es par les cellules cili�es
5- Deux petits muscles dans l�oreille moyenne : le tenseur du tympan, le muscle stap�tien.
�
Les affirmations 4 et 5 sont exactes.
Affirmation 1
Non.
[A] : Membrane tympanique.
La choro�de est l�enveloppe fibreuse de l��il.
Affirmation 2
Non.
[B] : oreille moyenne.
L�oreille moyenne comprend : le tympan, la caisse du tympan, la trompe d�Eustache.
Affirmation 3
Non.
Les ondes sonores :
- sont des vibrations des mol�cules d�un milieu (air, eau,�),
- ne se propagent pas dans le vide,
- arrivent aux cellules cili�es qui les d�tectent, par les vibrations de leurs cils, et les transforment en potentiel d�action
PA
Affirmation 4
Oui.
Le marteau, l�enclume, l��trier sont de tr�s petits os.
Affirmation 5
Oui.
Muscle tenseur du tympan : figure (1)
Muscle stap�tien : figure (2).
R�flexe stap�dien :
Att�nuation de l�intensit� sonore transmise � l�oreille interne par contraction du muscle de l��trier.
Stapia : �trier en latin
Page 2.
Oreille. Vue d�ensemble
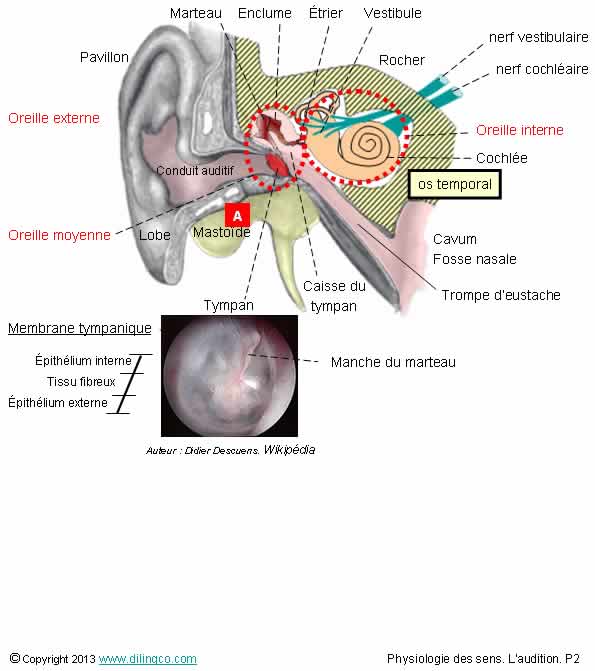
S�lectionnez les deux affirmations exactes :
1- L�oreille ne communique pas avec la fosse nasale
2- Trois osselets de la caisse tympanique : le marteau, l�enclume, l��trier
3- Les vibrations m�caniques font vibrer les nerfs auditifs et le cerveau
4- Toit osseux de l�oreille moyenne et interne = rocher de l�os temporal
5- Toit osseux de l�oreille moyenne et interne = processus masto�de
6- Le m�at acoustique interne se trouve dans la partie tympanique de l�os pari�tal
7- [A] : L�oreille moyenne ne communique pas avec les cellules masto�diennes
Les affirmations 2 et 4 sont exactes.
Affirmation 1
Si.
L�oreille
communique avec le cavum/fosse nasale par la
trompe d�eustache.
Raisons :
- ventilation de l�oreille moyenne,
- r�gulation des pressions n�cessaire � la mobilit� du tympan,
(Encombrement de la trompe d�Eustache, rhume = diminution des capacit�s auditives)
- �viter la rupture du tympan suite � des variations brusques de pression.
Affirmation 2
Oui.
Le marteau transmet les vibrations de la membrane du tympan � l��trier par l�interm�diaire de l�enclume.
L�oreille moyenne assure l�amplification/limitation (r�flexe stap�dien) des sons pour les transmettre au milieu liquide de l�oreille interne.
Affirmation 3
Non, pas directement.
Les ondes sonores sont traduites en ondes �lectriques (Potentiel d�action).
Le PA est transmis au cortex auditif.
Affirmation 5
Non.
Les cavit�s de l�oreille moyenne et interne sont dans l�os temporal.
Le rocher (os p�treux) constitue la partie sup�rieure de l�oreille interne.
Affirmation 6
Non.
Le m�at acoustique interne se trouve dans la partie p�treuse de l�os temporal.
L�os temporal est form� de trois parties soud�es :
- L��caille,
- La partie tympanique
- Le rocher (ou partie p�treuse/os p�treux).
Affirmation 7
Si.
[A] : L�oreille moyenne communique avec les cellules masto�diennes
Une otite (inflammation de la peau ou de la muqueuse de l�oreille), peut s��tendre aux cellules masto�dienne (masto�dite).
Page 3.
Le son
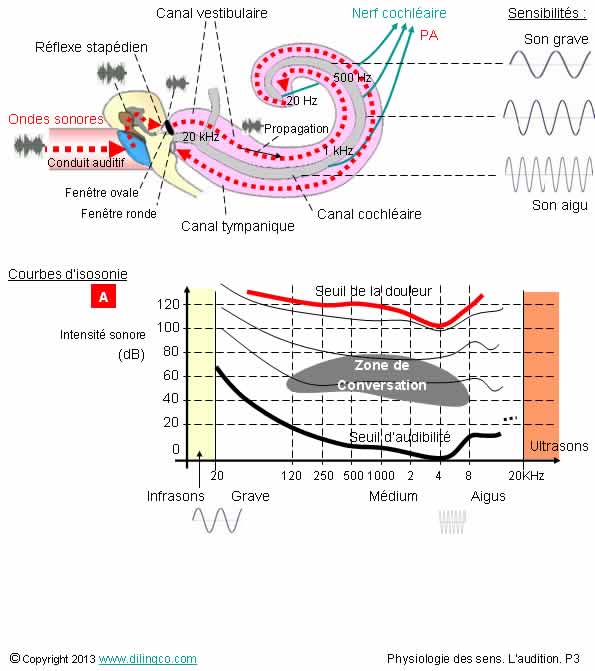
S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- L�oreille humaine peut percevoir les infrasons et les ultrasons
2- Les ondes sonores se propagent dans le vide
3- [A] : Les courbes d�isosonie (courbes d��gale sensation), montrent que la sensibilit� de l�oreille ne d�pend pas des caract�ristiques du son
4- Les lieux de r�sonance (vibrations maximales) sont r�partis, en fonction des fr�quences soniques (auteur du son), sur la longueur de la cochl�e
L�affirmation 4 est exacte.
Affirmation 1
Non.
Sensibilit� de l�oreille interne : 20 � 20 000 Hz
(22 000 Hz pour les femmes).
Zones de meilleure sensibilit� : 1000 � 4000 Hz.
Les sons tr�s aigus ne sont plus per�us par les personnes �g�es.
Les ultrasons, sons tr�s aigus, sont per�us par les chiens, les chauves-souris, �
Les infrasons, sons tr�s graves, sont per�us par les �l�phants, �
Affirmation 2
Non.
Ne pas confondre les ondes sonores avec les ondes �lectromagn�tiques. Les ondes �lectromagn�tiques se propagent dans le vide.
Les ondes sonores sont les vibrations m�caniques d�un milieu.
L��lasticit� du milieu a un r�le dans la propagation sonore :
-� 340 m/s dans l�air.
- moins de pertes, meilleure propagation, dans l�eau que dans l�air,
- Les solides transmettent mieux encore les ondes sonores
(Lucky Luc, son oreille et le rail de chemin de fer).
Affirmation 3
Si.
Les courbes d�isosonie montrent que la sensation auditive d�pend des caract�ristiques du son :
- sensibilit� diminu�e aux basses fr�quences,
- la sensibilit� aux bruits forts varie moins que celle aux bruits faibles.
R�flexe stap�dien :
Att�nuation de l�intensit� sonore transmise � l�oreille interne par contraction des muscles de l��trier
Stapia : �trier en latin
Page 4.
Labyrinthes osseux & membraneux
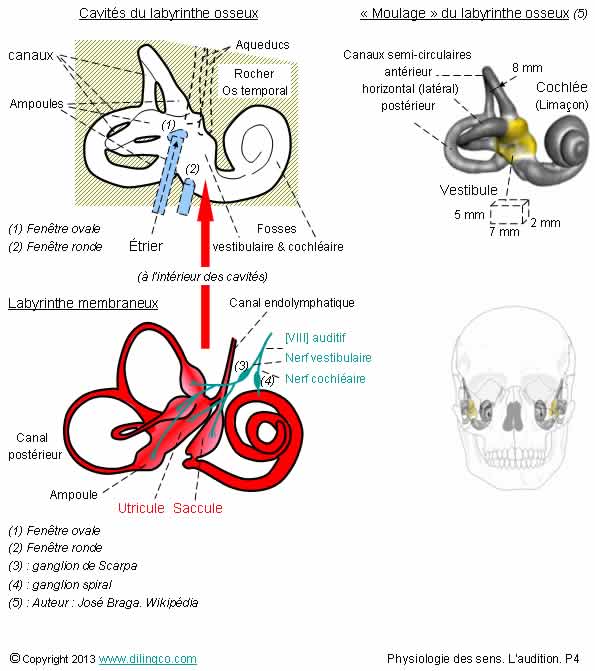
S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Le labyrinthe membraneux est dans l�oreille moyenne ; le labyrinthe osseux dans l�oreille interne
2- Le labyrinthe osseux, ensembles de cavit�s du rocher de l�os temporal, contient le labyrinthe membraneux
L�affirmation 2 est exacte.
Oreille interne :
Page 5.
Labyrinthe membraneux

S�lectionnez les deux affirmations exactes :
1- Organe de l��quilibre : la cochl�e. Organe de l�audition : le vestibule
2- Le vestibule membraneux : utricule + saccule + 3 canaux semi-circulaires situ�s dans 3 plans perpendiculaires
3- Les 3 canaux (ou rampes) du lima�on : le canal vestibulaire, le canal tympanique, le canal cochl�aire
4- Les trois canaux sont reli�s entre eux par l�h�licotr�me, orifice situ� � l�apex du labyrinthe membraneux
5- La fen�tre ovale, qui vibre � la fr�quence de l��trier, est � l�entr�e de la rampe tympanique
6- L�endolymphe est le liquide qui se trouve dans le canal vestibulaire et le canal tympanique
Les affirmations 2 et 3 sont exactes.
Affirmation 1
Non.
Organe de l��quilibre : le vestibule.
Le vestibule est impliqu� dans la maladie de M�ni�re.
Organe de l�audition : la cochl�e.
(Ou lima�on, ou labyrinthe membraneux)
Affirmation 2
Oui.
Les r�cepteurs vestibulaires des canaux, situ�s dans trois plans perpendiculaires, sont sensibles � la position de la t�te, aux acc�l�rations
(Tourner sur soi-m�mes, man�ges, �).
Le vestibule membraneux peut �tre compar� � une centrale � inertie.
Le mouvement, les acc�l�rations, du liquide interne (l�endolymphe), n�ont pas les m�mes effets sur des cellules r�ceptrices r�parties sur des axes orthogonaux.
Affirmation4
Non.
Seul le canal vestibulaire est reli� au canal tympanique.
Page 6.
R�ception des sons
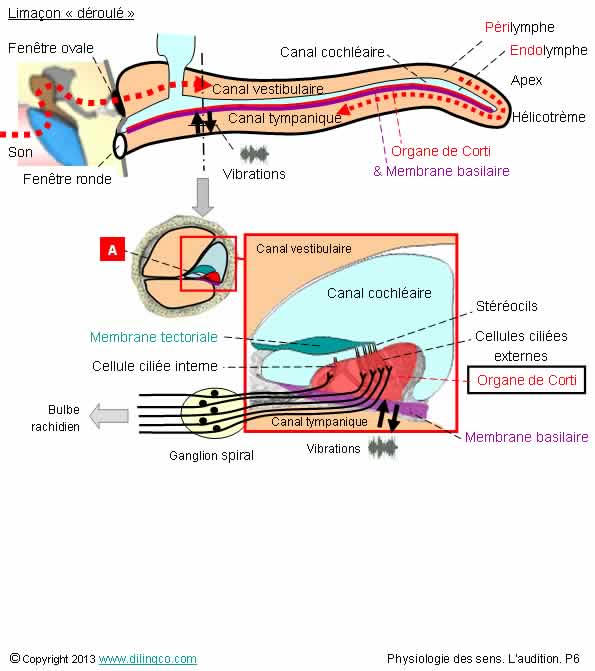
S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- La propagation d�un son dans le canal tympanique provoque des pressions identiques des deux c�t�s de la membrane basilaire
2- L�organe de Corti est une bande sensorielle h�lico�dale support�e par une membrane flexible, la membrane basilaire
3- Les noyaux des neurones reli�s aux cellules sensitives sont dans l�organe de Corti
4- [A] : ganglion spiral
L�affirmation 2 est exacte.
Affirmation 1
Non.
La propagation d�un son dans le canal tympanique provoque des �carts de pressions entre le canal tympanique et le canal cochl�aire.
La membrane basilaire et l�organe de Corti vibrent au rythme de ces variations de pressions.
Les cellules cili�es de l�organe de Corti g�n�rent, par le frottement des st�r�ocils sur la membrane tectoriale, des potentiels d�action en direction du cortex auditif.
Affirmation 3
Non.
Neurones reli�s aux cellules sensitives de l�organe de Corti :
- noyaux situ�s dans les ganglions spiraux
(Voir page pr�c�dente).
- neurones bipolaires,
- les axones de ces neurones se regroupent pour constituer le nerf cochl�aire puis le nerf vestibulo-cochl�aire ; nerf auditif [VIII].
Page 7.
Transduction Son / PA

S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Il y a plus de cellules cili�es internes que de cellules cili�es externes
2- Les st�r�ocils des cellules cili�es internes n�entrent en contact avec la membrane tectoriale que si l�intensit� sonore est suffisante
L�affirmation 2 est exacte.
Affirmation 1
Non.
Il y a environ trois fois plus de cellules cili�es externes que de cellules cili�es internes.
(12500 CCE contre 3500 CCI environ)
Les cellules cili�es internes sont rang�es sur une ligne.
�
Affirmation 2
Oui.
Le contact des st�r�ocils CCI avec la membrane tectoriale ne s��tablit que si le son est sup�rieur � 50 dB.
PA : Potentiel d�action
Page 8.
PA� cochl�aires

S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Stimulation sonore = diminution du nombre de PA dans les fibres nerveuses auditives
2- Les cellules cili�es sont des neurones
3- Plus le son est fort, plus la fr�quence d��mission de PA est �lev�e
4- Le potassium provient des canaux vestibulaires & tympaniques. Il est s�cr�t� par les cellules de la membrane basilaire
L�affirmation 3 est exacte.
�
Affirmation 1
Non.
Stimulation sonore = augmentation du nombre de PA.
Affirmation 4
Non.
Le potassium provient de l�endolympe du canal cochl�aire.
Il y est s�cr�t� par les cellules des stries vasculaires.
Voir page pr�c�dente.
La compression des ponts prot�iques par les st�r�ocils ouvre les canaux ioniques au potassium.
Le cycle des r�actions en cha�nes (figure : 1, 2, 3, 4) va se poursuivre tant que les st�r�ocils compriment les ponts prot�iques.
�
Voir aussi :
Neurotransmetteurs
Concentrations LEC/LIC
Canaux / Tansporteurs / Pompes
Potentiel d�action. PA
Page 9.
Voies auditives
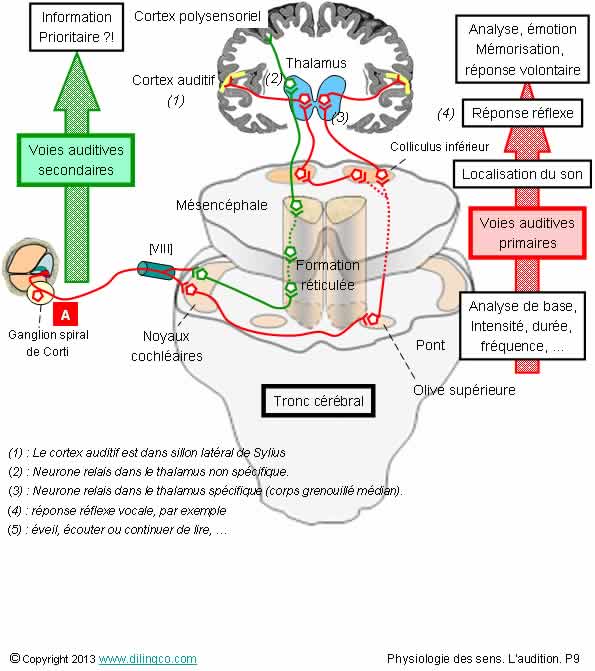
S�lectionnez l�affirmation exacte :
1- Les r�flexes d�orientation li�s � la localisation d�un son sont du ressort du cortex auditif
2- La formation r�ticul�e du tronc c�r�bral ne contient que les relais neuronaux propres aux sensations auditives
3- [A] : Cochl�e & neurones sensoriel primaire du ganglion spiral. [VIII] : nerf vestibulo-cochl�aire (nerf auditif)
4- Les sons sont capt�s par les deux oreilles mais il n�y a qu�une seule voie auditive et seul le cortex auditif droit est actif
�
L�affirmation 3 est exacte.
Affirmation 1
Non.
Les r�flexes d�orientation li�s � la localisation : colliculus inf�rieur.
Affirmation 2
Non.
La formation r�ticul�e :
- s��tire sur toute la longueur du tronc c�r�bral,
- ses neurones participent � des fonctions motrices/autonomes
(R�gulation de la marche, veille/sommeil, r�flexes, �)